Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?« Le vide politique du cinéma français » vu par les Cahiers du cinéma
Les Cahiers du cinéma, qui vont fêter en 2016 leur 65e année de publication, mettent, dans leur numéro de septembre, les pieds dans le plat politique. Sous le titre provocateur « Le vide politique du cinéma français », le dossier s’interroge sur la fiction hexagonale, activité en bonne santé financière, qui « fait tout pour se débarrasser de la politique » comme l’écrit dans son éditorial Stéphane Delorme. Le rédacteur-en-chef fustige la tendance au cinéma social qui « ne mange pas de pain » et, avec pour exemple le long-métrage La loi du marché, « dresse des constats, toujours désabusés, de situations qui semblent inévitables ». Il s’en prend également à la tendance « quittons ce monde pourri » qui ne croit pas à un « possible politique puisque le peuple et le monde sont précisément ce qu’il faut fuir ». La troisième tendance est incarnée par la Palme d’or de Cannes, Dheepan de Jacques Audiard, film dans lequel les Cahiers voient un cinéma de clichés sociaux.
Un article de Joachim Lepastier consacré aux films de l’année, comme La Belle Saison ou Journal d’une femme de chambre, résume ainsi le problème : « Ces films convoquent des grandes questions, mais ne se mouillent pas ». Le dossier des Cahiers décrypte un nouveau personnage du cinéma français : le gardien, homme incolore qui protège la propriété d’autrui sans intervenir, personnage idéal de « l’immersion » que l’on pourrait opposer à l’émancipation. Dheepan a pour héros un gardien d’immeuble, Maryland un garde du corps, La loi du marché un vigile, Ni le ciel ni la terre des sentinelles…
Pour Stéphane Delorme, le vide du cinéma répond au vide des esprits qu’il dénomme « BFMisation des cerveaux » et estime, à partir du film d’Audiard, que « la fiction annule le potentiel politique ». Est convoqué le philosophe Jacques Rancière et sa distinction entre police et politique.
Deux films des années 2010 contrebalancent heureusement cette « lâcheté » politique, Dernier maquis de Rabah Ameur-Zaïmeche et Les neiges du Kilimadjaro de Robert Guédiguian.
Le cinéma européen trouve à peine meilleure grâce aux yeux des Cahiers. Rappelons néanmoins Le Labyrinthe du silence de l’allemand Giulio Ricciarelli qui déchire le voile sur la fausse dénazification de la RFA au moment où la jeune génération allemande du XXIe siècle s’interroge sur la période du miracle économique. Également La Isla Minima de l’espagnol Alberto Rodriguez qui dépeint l’Espagne postfranquiste dans un polar où les lignes politiques traditionnelles sont bousculées, ou Les Merveilles de l’italienne Alice Rohrwacher qui justement dénoue le mythe du « quittons ce monde pourri » tout en se gardant des illusions agit-prop des années 68. Comme quoi le cinéma peut parler de politique en faisant du neuf. Ce qui semble difficile pour le cinéma français frappé « d’impossibilité foncière » à « aller à l’aventure ».

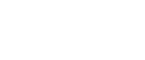 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
