Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Yohanne Lamoulère : « Je n’ai pas envie de faire des images marseillaises »
Qu’est ce qui caractérise votre travail ?
J’ai d’abord été à la fois construite et déconstruite par l’école de la République. Construite en primaire, dans une école où l’expression artistique avait beaucoup de place et où j’ai appris sur l’art. Déconstruite au collège, où je n’arrivais pas à suivre et où je me suis sentie très vite exclue. Je viens d’un milieu populaire, mais j’ai eu très tôt le désir de devenir photographe. Pour dire ce que j’avais à dire, il me semblait que l’image était plus forte que les mots. Il fallait un DEUG pour entrer à l’école de photographie d’Arles, je me suis donc inscrite à Montpellier en histoire de l’art. À Arles, j’ai eu beaucoup de chance. Les professeurs, et les rencontres que j’ai faites m’ont fait évoluer dans ma pratique et dans le chemin que je voulais prendre. Je n’ai jamais voulu faire une belle image, l’image doit s’imposer à moi. Dès le début j’ai souhaité inscrire un militantisme dans mes images, inscrire toujours d’où je viens. J’ai pu le faire avec mon mémoire de fin d’étude en suivant des travailleurs agricoles migrants, venus d’Afrique, d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine pour travailler en France et en Espagne. Ces photographies, publiées dans le livre La roue (Khiasma Sud 2007), sont accompagnées des textes de Patrick Herman.
Quelle image recherchez-vous ?
Elle résulte avant tout d’une proximité, d’un échange, de mon rapport à l’autre ou à un endroit. Quand je photographie quelqu’un, la personne me fait confiance et je reçois énormément, alors je lui demande toujours ce qu’elle veut en échange. Des photos pour un casting, un portrait d’identité, de sa famille, etc. Ce que les personnes me donnent d’elles-mêmes pour faire mes photos, je veux le leur rendre. C’est comme ça que j’entends mon métier de photographe.
Pour beaucoup, je suis une photographe de Marseille. C’est que je vis à Marseille, et depuis une vingtaine d’années je photographie la ville avec mon Rolleiflex, des coins peu connus, des gens qui vivent simplement là. J’habite les quartiers nord, c’est un endroit que j’aime. Mais aujourd’hui tout a changé. La plupart des endroits que j’ai photographiés dans le livre Faux Bourgs n’existent déjà plus, beaucoup d’endroits que j’aimais ont disparu. La ville est devenue artificielle, se donne une façade qui la rend impersonnelle. Je ne m’y reconnais plus. En 2019, j’ai fait Manger tes yeux, une série autobiographique créée au lendemain des effondrements de la rue d’Aubagne à Marseille.
Comment vos photos sont-elles perçues ailleurs ? Par ceux qui ne connaissent pas la ville ?
Je veux que mes photos soient vues par tout le monde. Je n’aime pas la culture avec un grand C, qu’on juge par rapport à qui l’on est. C’est très autoritariste, dominant. À trop souffrir, à trop pâtir de ça, on s’extrait, on essaie d’insuffler dans les images un sens universaliste. Je n’ai pas envie de faire des images marseillaises. J’ai envie de faire des images qu’on peut lire à Madrid, à Camden, à New-York. À l’extérieur, elles sont perçues très différemment.
Je me souviens d’une discussion avec un groupe de Lyonnais que je recevais alors que j’exposais dans la médiathèque de Lyon. Je décide de faire ce test, de leur faire dire ce qu’ils lisent dans mes images. Je les interroge sur deux photos, sur l’une d’elles un jeune garçon est assis sur un muret de la cité la Savine, à l’arrière-plan on distingue une tour qui vient d’être détruite, le décor urbain est arboré, c’est sale par terre, il fait un grand soleil. Je leur demande ce qu’ils voient, ils me répondent : c’est un garçon sur un muret qui prend le soleil, dans un espace vert, ça a l’air chouette. Si je montre cette image à n’importe quel Marseillais, immédiatement il va me dire : c’est un guetteur. C’est pour ça que je ne veux pas mettre de légendes. On n’a pas besoin de savoir que c’est un guetteur, cette image ne m’intéresse pas parce que c’est un guetteur. Certains y verront une tension, d’autres non. C’est ça aussi la richesse d’une image. L’autre photo était celle d’un bras sur lequel il y a un coq, et en arrière-plan des oliviers flous. Les jeunes Lyonnais me disent ça c’est le coq, le symbole de la France. À Marseille, tout le monde me dit : ah ben ça c’est les gitans. L’endroit où j’ai fait la photo c’est effectivement ça.
J’ai fait le livre Faux Bourgs, où figurent ces deux photos, en 2018. C'était ma première revendication, que ce livre avec ces jeunes soit aussi vu dans les pays anglo-saxons. Or les textes n’ont pas été traduits en anglais. En revanche, ils sont en provençal, c’est aussi ce que je voulais, mais mon éditrice m’a demandé de les mettre aussi en français. Je viens d’un endroit où ma première bagarre est de dire que ces jeunes sont aussi provençaux.
Vous avez malgré vous l’image de la photographe de Marseille…
Pourtant je me sens déjà dans le Marseille d’hier, des jeunes photographes qui arrivent derrière moi ont eux l’image du Marseille d’aujourd’hui. J’ai besoin de détestation, mais j’ai aussi énormément besoin d’amour. Je ne peux pas continuer à photographier un endroit dans lequel je suis en contradiction permanente. J’ai l’impression de vivre dans un décor, dans l’artifice, quel que soit le quartier, de Malmousque à La Joliette. Il n’y a plus d’authenticité, même dans les quartiers nord. Là où j’ai retrouvé une authenticité c’est à Port Saint Louis du Rhône, au bord du fleuve. On m’a prêté une cabane et je m’y sens bien.
Où vos images se positionnent-elles le mieux dans la société ?
Ce que j’aime c’est partager mes images avec des gens, avec des groupes, en prison, dans une salle d’exposition, ou ailleurs. Je leur parle de mes photos, et je réponds à leurs questions. Récemment c’étaient des lycéens, la semaine prochaine j’accueille des gens en service civique.
Quels sont vos projets ?
Vers la fiction. Je vais faire un film. Il sera très court. Je ne le fais pas pour la télévision, je le fais surtout pour les jeunes. C’est un peu un bouquet final. Il s’agit d’un huis clos qui se passe sur un rond-point et son environnement proche, avec quelques personnages. Il y a un peu de musique mais ni son ni dialogue. Ce sera un film étrange, mais simple. Un producteur me fait confiance et le théâtre du Merlan m’accompagne dans l’écriture. Je suis très privilégiée dans mon travail, de nombreuses personnes me font confiance.
Bio
Née en 1980 à Nîmes, formée à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, Yohanne Lamoulère s’est installée au nord de Marseille. Elle intègre Tendance Floue, collectif de seize photographes, primé internationalement pour ses réalisations à la croisée du social, du culturel, du documentaire et de l’artistique, aujourd’hui reconnu comme un acteur majeur de la photographie française. Azimut, dernier projet du collectif, a fait l’objet d’une exposition au Musée Nicéphore Niepce à Chalon sur Saône et d’un livre aux éditions Textuel. Dernièrement, son exposition personnelle Virage au Merlan scène nationale de Marseille étant reportée en raison de la crise sanitaire, elle en publie un fanzine auto-édité tiré à 500 exemplaires.

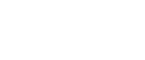 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
