Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Dans la banlieue, les valeurs de la République discréditées
Vous avez étudié l’implantation de l’Islam en France il y a un quart de siècle, en quoi votre ouvrage "Banlieue de la République" est-il un prolongement de ce travail ?
Il y a 25 ans j’avais travaillé sur la naissance de l’islam en France, puis j’avais suivi l’évolution des choses sans y avoir consacré de nouveau un travail de fond. Or, trois générations ont passé en un quart de siècle et beaucoup de choses ont changé. La première fois il s’agissait de faire une étude horizontale qui allait à la rencontre d’un phénomène totalement inconnu alors. Cette fois, il s’agissait de faire une enquête en profondeur, un carottage, pour voir comment dans un territoire de banlieue populaire enclavé s’articulent des enjeux importants que sont l’habitat avec la politique de rénovation urbaines, l’éducation, le travail ou son absence, la sécurité, la participation au politique et la question religieuse.
Pourquoi le parti pris du territoire de Clichy-Montfermeil ?
Ce territoire a été choisi parce que c’est là que les émeutes des banlieues ont commencé en 2005. Quand on a fait l’enquête en 2010 nous étions cinq ans après les faits. Les gens en avaient encore une mémoire très fraîche et, en même temps, pouvaient commencer à en faire l’histoire, c’est-à-dire les distancier. Il y avait des témoins et en même temps on n’était plus dans la passion, on commençait à réfléchir à ce qu’était, du point de vue des habitants, le phénomène de l’émeute. Le milieu associatif refusait parfois d’employer ce terme, le requalifiant en « révolte sociale » pour tenter de le transformer en action politique. On a pu voir aussi comment l’émeute est née à partir de deux éléments : l’électrocution de deux jeunes qui s‘étaient réfugiés dans un transformateur et ce qu’on a appelé le gazage de la mosquée Bilal, c’est-à-dire l’arrivée malencontreuse d’une grenade lacrymogène à l’entrée d’une mosquée aux portes ouvertes où les gens étaient en prière le soir du ramadhan. Un certain nombre a dit que la police avait fait exprès d’attaquer l’islam.
Ce que vous avez observé sur ce territoire hors normes permet-il d’apporter un éclairage plus général sur ce qui se passe dans d’autres quartiers difficiles ?
Nous avons utilisé une méthode inspirée de Max Weber, celle de la construction d’un type idéal. Il s’agit d’observer un phénomène qui, dans son contexte, est exacerbé et qui rend manifeste des choses qui ailleurs seraient latentes. Ce qu’on voit à Clichy-Montfermeil ne peut pas être reproduit comme tel partout ailleurs. Mais j’ai été très frappé de constater la prévalence du mariage homogamique dans la population d’origine musulmane de l’agglomération alors qu’on considère d’ordinaire que la France de l’intégration est caractérisée par la masse des mariages mixtes. Est-ce que c’est un problème qui est dû à l’enclavement particulier de cette agglomération ? Est-ce que c’est un phénomène qui anticipe des choses qui se passent plus en profondeur dans la société française ? L’intérêt c’est de découvrir le phénomène, d’en voir des éléments pour y réfléchir.
Qu’est-ce qui reste aujourd’hui des émeutes de 2005 ?
Elles ont construit une représentation sociale qui s’est inscrite dans une logique de victimisation. On y trouve la source du phénomène de traînée de poudre qui s’est répandu à la France entière. Mais contrairement à ce qu’ont dit beaucoup de journalistes, notamment américains, il ne s’agissait pas d’émeutes musulmanes. Il n’en reste pas moins que ça s’est passé pendant le ramadhan et qu’elles étaient structurées sur le tempo de ce dernier. Le matin c’était très calme, ça a commencé après le repas de rupture du jeûne. On mettait le feu pour attirer les pompiers, on les caillassait pour attirer la police, et tout ça pendant que les parents étaient à la mosquée pour la prière. Quand les parents revenaient au milieu des fumées et des lacrymo, ça se calmait. Beaucoup disent combien c’est étonnant que la représentation médiatique en ait fait une sorte d’émeute permanente, alors que ça se produisait à un moment donné de la journée. On le comprend bien en interrogeant les gens. Je dirais aussi que l’image de l’émeute ne doit pas donner l’impression qu’on est dans un ghetto : on n’est pas non plus les oubliés de la société. 600 M€ ont été investis à Clichy-Montfermeil dans des opérations de rénovation urbaine, ce n’est pas rien pour une agglomération de 60 000 habitants dont 15 000 seulement sont directement concernés par la rénovation.
Qu’est-ce qui ne marche pas, alors ?
Le problème est que si on ne fait que mettre la même population dans des logements rénovés, et que si celle-ci reste sans emploi et surtout sans prise en charge éducative dès le plus jeune âge, alors tout va recommencer. Le risque est que cette fois ce sont ceux qui ont payé les impôts pour financer la rénovation qui se révoltent. L’enjeu majeur aujourd’hui c’est le passage du béton à l’humain. Le principal levier avec l’emploi, est celui de l’éducation.
Quelle place occupe l’école aujourd’hui sur ces territoires ?
Le problème n’est pas tant dans le contenu de l’enseignement que dans la manière dont l’école est insérée dans le tissu social. Autrefois elle s’inscrivait dans un contexte de milieu ouvrier, avec des organisations de jeunesse, des camps de scouts… Mais la culture ouvrière a disparu avec le travail posté et ce que font les municipalités ne peut pas véritablement la remplacer. Cela conduit à une sorte de mise à distance de l’institution scolaire, à la fois parce qu’elle est considérée comme donnant des savoirs qui sont très peu valorisés sur le marché du travail, et parce que les emplois qu’elle procure ne sont pas valorisés. Donc les valeurs dont elle est porteuse et notamment la laïcité ou l’ascension sociale, ne sont pas aujourd’hui reçues comme elles devraient l’être.
Dans votre enquête, vous évoquez le conseiller d’orientation comme le personnage plus détesté, avant même le policier. D’où vient ce ressentiment ?
Il est temps que l’on passe à la phase 2 de la rénovation urbaine. La phase 2 c’est l’éducation débouchant sur l’emploi. C’est pourquoi l’éducation c’est le gros morceau. Moi je n’ai rien contre les conseillers d’orientation, on ne fait que rapporter ce qui nous a été dit. Quand on pose la question : « alors, en troisième comment s’est passée l’orientation ? », la personne qui était parfaitement calme sort de ces gonds et, vingt ans après, peut encore raconter la scène, comment elle a été selon elle mal orientée vers des filières non valorisantes. On constate chez nombre de personnes interrogées, la construction sociale rétrospective d’un échec imputable au conseiller d’orientation, même si ce dernier n’est pas forcément responsable.
Ce ressentiment touche-t-il uniquement la fin du collège ou concerne-t-il également le primaire ?
Le hiatus majeur se produit en fait au passage du collège au lycée. Jusque-là on reste dans l’entre soi, les enfants de la cité restent ensemble du primaire à la fin du collège. C’est pour ça que l’orientation est traumatique. Quelques-uns iront dans un lycée, la plupart vont basculer dans la voie professionnelle, ce qu’ils perçoivent comme une déchéance.
A l’opposé, ce qui nous a beaucoup frappés c’est le problème de la petite enfance. Dans une agglomération comme Clichy-Montfermeil, il y a une population très diverse avec beaucoup d’enfants très jeunes qui viennent essentiellement d’Afrique sahélienne. Souvent les parents sont des primo-arrivants, les mères travaillent énormément, elles sont femmes de ménage, elles font de longues heures de travail pas très bien payées, elles tombent très fréquemment enceintes parce que le modèle reproducteur reste celui du village d’origine et n’est pas pensé en fonction des contraintes de la société d’accueil. Les enfants sont fréquemment laissés à eux-mêmes, ce qui est d’ailleurs la hantise des mères, un certain nombre préfère les renvoyer auprès des grands-parents au village natal plutôt que d’être soumis aux mauvaises influences.
La situation est d’autant plus compliquée en Seine-Saint-Denis que la maternelle à deux ans n’est quasiment plus assurée. Il y a tout un débat là-dessus, je ne suis pas un spécialiste de pédagogie. Certains considèrent qu’il faut scolariser à deux ans, d’autres qu’il faut des maisons de la petite enfance… Mais le paradoxe est qu’autant de gens focalisent sur l’orientation à la fin de la 3e alors que la raison pour laquelle il y a autant de difficultés d’orientation à la fin du collège, c’est que dès lors qu’on a redoublé le cours préparatoire on est très très mal barré. C’est dès le plus jeune âge qu’il faut faire porter l’effort.
Ce constat signe-t-il l’échec des politiques d’éducation prioritaire ?
Pas forcément. Il y a aussi de très beaux itinéraires de réussite dûs pour partie à l’école, au lycée, aux orientations bien faites. Il y a des enfants qui ont travaillé, qui ont vu à quoi sert l’éducation dans ces quartiers, notamment à donner le sentiment qu’on peut échapper à la fatalité sociale. Néanmoins, on a l’impression que le dispositif marque le pas. Est-ce les ZEP qui posent problème en tant que dispositif spécifique, ou au contraire n’est-ce pas la trop grande uniformité du fonctionnement du système scolaire ? Ne serait-il pas temps, en fait, de réfléchir à une articulation globale de l’éducation avec la rénovation urbaine, qui inclut non seulement l’enseignement, mais aussi l’encadrement et l’accompagnement des élèves ?
N’est-ce pas là le rôle de la politique de la ville ?
Oui, mais ce n’est pas encore fait. Dans le rapport entre l’Agence nationale de rénovation urbaine, qui représente le béton, et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, qui est l’humain, la seconde est réduite à la portion congrue. L’argent est du côté du béton. C’est un enjeu important que de réarticuler la politique de la ville à travers l’éducation elle-même, mais aussi à travers tout ce qui va permettre aux enfants de vivre dans des conditions et dans un environnement qui les rendent aptes à recevoir et à mettre en œuvre un enseignement de qualité.
Comment l’interdiction du port de signes religieux ostensibles est-elle perçue dans les établissements scolaires de ces quartiers ?
Dans les collèges et les lycées de Clichy la loi issue de la commission Stasi est acceptée. Les filles voilées enlèvent le voile à l’entrée et le remettent à la sortie. Cela a considérablement contribué à pacifier l’atmosphère dans les établissements où les mouvements islamistes s’efforçaient d’utiliser cette histoire pour imposer un rapport de forces et faire passer leurs valeurs. Cela étant, ça été accepté mais pas compris. Les organisations islamiques qui refusent l’intégration considèrent que la laïcité n’est pas un enjeu, sous-entendu il faut rester clos dans nos valeurs et négocier à partir de celles-ci. Je crois que si la laïcité et l’intégration passent mal aujourd’hui dans certains quartiers, c’est parce qu’on n’a pas réussi à leur donner leur signification émancipatrice et valorisante qui étaient celles du début.
Vous faites également le constat de la faible fréquentation de la cantine, en quoi est-elle dommageable à l’école ?
La surenchère au halal est devenue un enjeu très important pour un certain nombre d’associations proches notamment des frères musulmans. Elles voient là à la fois un enjeu financier puisque ça permet aux sandwicheries locales de fonctionner, mais c’est aussi une manière de marquer la rupture, de mettre l’école à distance pour contrôler les âmes. Aujourd’hui, il y a des restaurants scolaires qui ne peuvent quasiment plus fonctionner faute d’élèves en assez grand nombre. La non fréquentation de la demi-pension conduit les jeunes non seulement à manger des sandwiches pas très diététiques bien que halal, mais surtout à trainer dans les coursives. La cantine est avant tout un lieu de socialisation. Il y a là une vraie réflexion à mener. Certains pays ont considéré qu’on pouvait proposer du halal à la cantine. En France ce n’est pas la tradition, on considère que cela peut ouvrir la porte à d’autres revendications porteuses d’autres valeurs. Je crois qu’on peut proposer des gammes de menus dans lesquels il y a des options multiples pour les gens, mais cela implique une certaine masse critique. D’autre part, il faut bien savoir que chez les musulmans tout le monde n’est pas d’accord sur le halal et son contenu.
Que dit cette prédominance du halal parmi la population musulmane de Clichy-Montfermeil ?
C’est avant tout une question d’enjeux identitaires. Le halal traverse une communauté de consommateurs reliant des populations privées d’un mode d’expression politique. Leurs parents, les travailleurs immigrés, ont été anéantis politiquement en perdant leur rôle dans le processus de production à partir de la crise des années 70. Devenus chômeurs immigrés et non pas travailleurs immigrés au chômage, ils ont disparu de l’espace public. Leurs fils reviennent avec une exigence consommatrice qui se traduit par la halal. C’est un problème sérieux auquel il faut réfléchir. L’école s’articule autour de deux choses : des savoirs qui vont permettre l’accès au marché du travail dans de meilleures conditions que les parents, et des valeurs. Si les savoirs ne sont pas procurés, alors les valeurs vont être discréditées automatiquement et s’y substitueront notamment des valeurs religieuses qui, elles, donnent un sentiment de valorisation.
Comment reprendre la main ?
Nous avons voulu lancer un débat en apportant des données qui, je crois, sont très largement inédites. Pour l’école, nous avons rencontré des enseignants, des directeurs, des directrices, des personnages très impressionnants qui croient à leur métier, sont admirables. Ils m’ont donné le sentiment que rien n’est foutu. Contrairement à ce que l’on peut lire par-ci par-là, on n’est pas dans le ghetto, mais on n’en est pas loin et il faut qu’on arrive à coordonner les politiques. Les différents services sont complètement juxtaposés : le lycée ne parle pas aux acteurs de la rénovation urbaine, qui ne parlent pas au commissaire de police, qui lui-même parle à peine au maire. En fait c’est ce dernier qui est un peu le facteur commun, mais je ne crois pas que ce soit suffisant. L’idée pour nous est de mettre tout ça en débat. Je pense qu’on dispose en banlieue populaire d’un réservoir et de capacités exceptionnelles qui permettraient de créer des emplois à condition que l’éducation rende possible pour ces jeunes l’accès à des emplois valorisés.
Bio - Né en 1955, docteur en sciences politiques et en sociologie, Gilles Kepel est professeur à l’Institut d’études politiques de Paris depuis 2001 et membre senior de l’Institut universitaire de France depuis 2010. Spécialiste du monde arabe et de l’islam, il a publié de nombreux ouvrages sur les mouvements islamistes. Il fut l’un des premiers chercheurs français à étudier les musulmans en France à travers son ouvrage Les banlieues de l’Islam, naissance d’une religion en France (1987). Il vient de publier Banlieue de la République. L’ouvrage, édité par Gallimard, ne sera diffusé que début 2012.

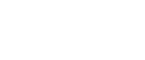 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
