Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Jean-Michel Othoniel, un généreux retour sur soi
Vous avez découvert l’obsidienne sur un île éolienne, vous vous êtes initié au travail du verre au CIRVA à Marseille, ce travail a été présenté en 1988 à Sète, où vous donnez aujourd’hui encore la primeur de nouvelles créations au CRAC, ce travail vous ramène toujours à la Méditerranée. Cela a-t-il un sens ?
Je n’y avais pas pensé mais il est vrai que ce rapport à la Méditerranée est très important. J’ai été très proche de l’Espagne pendant des années puisqu’une partie de ma famille vit en Andalousie. J’ai vécu à Madrid, à Rome, à Naples. L’art est né en Méditerranée, c’est une chose que je sens en moi. En découvrant les musées en Grèce quand j’avais 14 ans, je me suis senti dans cette histoire-là. J’avais l’impression de venir de là, de ces histoires mythologiques. Je me sens méditerranéen et c’est toute la gageure aujourd’hui c’est d’être ancré dans une culture et en même temps d’être global et mondial. C’est aussi de se dire qu’on fait une œuvre qui est portée, nourrie par une identité forte, mais que cette identité n’empêche pas qu’elle soit relue par un asiatique, par un Américain du nord ou du sud, un Hawaïen… C’est ce que je tente dans mon travail : être complètement français et avoir un travail suffisamment ouvert pour qu’il soit lu à l’international. C’est la gageure de tout artiste aujourd’hui. Une œuvre d’art doit être globale.
Si on rapproche vos créations de celles d'Europe du nord, comme Kosta Boda, il s’en dégage une très grande chaleur…
Oui, une chaleur et une sensualité. Parfois même un érotisme dans certaines formes, certaines couleurs. Une sensualité dans beaucoup d’œuvres du début qui ont ces couleurs de bonbon, de caramel, rappellent quelque chose du goût. Il y a aussi un côté gourmand.
Les formes que vous créez doivent être portées dans l’air, elles ne peuvent pas exister autrement que suspendues.
Ces œuvres-là sont en effet destinées à être suspendues. C’est un espace qui est peu utilisé en sculpture. Cela permet de se lover dans des architectures existantes, dans des collections existantes, c’est une façon d’infiltrer d’être suspendu. C’était un choix de sculpteur. En même temps, c’était affirmer une fragilité, une légèreté. Quand la lumière traverse le verre, la matière disparaît presque.
Dans votre démarche s’inscrit le rapport entre l’artiste et l’artisan. Vous arrivez comme une interruption dans le travail de l’artisan, vous êtes également surpris par la réalisation, vous souvenez-vous de la première fois ?
La première fois que j’ai travaillé à Venise, c’était un vrai rituel. Les fornace étaient fermés au public, c’était dans les années 80, Murano était alors florissant, les grandes boutiques de Fifth Avenue vendaient ses lustres. Après le 11 septembre, tout cela a disparu. À l’époque, c’était davantage que perturber c’était arrêter une chaîne de production. Pour eux, travailler avec un artiste c’était perdre de l’argent.
C’était très difficile. J’ai réussi grâce à plusieurs amis du musée Guggenheim, dont Marie Brandolini, et différents maestros du verre qui m’ont accompagné dans ces fornace pour dire aux artisans de prendre un peu de temps pour souffler pour cet artiste. Les verriers de Murano ne connaissent pas du tout l’art contemporain, peu d’entre eux sont allés au Guggenheim de Venise. Je pense pourtant que l’artisan a besoin d’un dialogue avec un artiste, un mécène, pour faire évoluer sa technique. L’idée de répétition est inhérente à la pratique du verre, à la fabrique d’une forme, d’un savoir-faire qui se transmet. Le problème est que ces formes s’épuisent, les gens estiment qu’un chandelier vénitien n’est plus à la mode. Du coup, des savoir-faire risquent de se perdre. Cette idée me bouleverse.
Pour qu’ils persistent, il faut que des artistes contemporains s’intéressent à ces techniques pour les faire vivre dans le monde d’aujourd’hui.
Au XXIe siècle l’impression en 3D permet de reproduire n’importe les qualités de transparence d’une perle, il est impensable pour vous d’y recourir ?
Des œuvres comme les Lotus, je les ai dessinées, modélisées sur ordinateur et réalisées avec une imprimante 3D. Avec ce modèle, je suis allé voir le verrier pour lui montrer la structure de l’œuvre et son volume. C’est grâce à ça qu’on a su le nombre exact de perles, les tailles. Ces techniques-là sont faites pour s’entraider. La 3D n’a rien contre l’artisanat, elle peut au contraire lui permettre de se développer différemment.
Donc c’était plus simple pour l’artisan ?
Oui parce qu’il avait un modèle avec le nombre exact de perles. Cela n’empêche pas que chaque perle a une sensualité que la machine n’aurait jamais pu créer. C’est très fort quand je fais des œuvres qui font 15 mètres de haut. Je suis obligé de les construire virtuellement avant. Mais le virtuel n’empêche pas le réel, comme le regard du contemporain n’empêche pas le regard classique d’évoluer. Il faut que ces différences s’apaisent. C’est vraiment dans un dialogue artisan/artiste qu’on arrivera à continuer. L’artisan est un interprète virtuose, sa virtuosité donne une grande liberté à la création.
Vous semblez partager avec de nombreuses personnes…
Je pense que ce qui fait la force du regard c'est l'écoute. Ce qui fait que vous voyez c'est que vous écoutez. C'est très important pour moi.
Qu'est-ce que vous entendez du monde aujourd'hui ? Votre dernière œuvre est une immense vague noire…
Ce qui est étonnant c’est que grâce à tout ce travail que je présente à Sète, à cette exposition, j’ai eu comme une révélation sur le sens profond de ces œuvres. Je les ai faites, je les ai installées et d’un coup j’ai réalisé que je parle du chaos, du changement climatique alors que je ne l’avais pas programmé. Les tornades, les météorites, la vague, le lotus noirci par l’homme, toutes ces œuvres que j’ai réalisées au cours des années parlent d’aujourd’hui. Je suis persuadé que l’œuvre est plus forte que l’artiste. À un moment, elle parle d’elle-même, elle parle même à celui qui la crée.
C’est pour ça qu’on retourne au musée. Parce que chaque fois qu’on va voir une œuvre on est différent, on y projette des choses différentes. Et elle nous parle différemment. Ces œuvres montrées me raconteront peut-être d’autres choses dans dix ans, mais là je les trouve d’une grande justesse par rapport à l’actualité, au monde.
Jean-Michel Othoniel est représenté par la galerie d’Emmanuel Perrotin. Après Paris, la galerie s’est implantée à New-york, Séoul en 2016, puis Tokyo en juin 2017. À New-York, elle a quitté Madison Avenue pour un building du très dynamique quartier de Lower East Side. Au 130 Orchard Street, elle y a investi une ancienne fabrique textile dont elle rénove les cinq étages. Le rez-de-chaussée, désormais achevé, accueille depuis avril une exposition de l’artiste colombien Ivan Argote. En novembre prochain, les œuvres de Jean-Michel Othoniel investiront la totalité des espaces. Celles actuellement exposées au CRAC de Sète seront rejointes par de nouvelles œuvres, pensées pour le lieu. Monumentales, les installations joueront avec l’architecture de ce beau bâtiment.

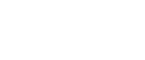 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
