Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Présidentielle française : les enjeux électoraux en termes négatifs
Si tous les candidats se réclament de la démocratie, les élections sont en général un moment dans la vie des sociétés où ce mot précise son contenu. La campagne électorale des élections présidentielles françaises n’échappe pas à la règle mais, dans un pays où les habitants fustigent allègrement le système, les dirigeants et les conditions de vie, des mots que l’on jugeait auparavant incompatibles avec la république ont pris le devant de la scène sans vraiment toutefois s’avouer comme tels. Antisystème, populisme, nationalisme, des concepts employés avant-guerre par cette partie de la droite qui collabora avec l'occupant ressurgissent, peut-être avec la disparition d’une génération qui les avait bannis jusqu’au refoulement, jusqu’à la négation même de leur existence.
Antisystème. Singularité des élections françaises, l’antisystème est une valeur recherchée. Des cinq candidats que les sondeurs voient en tête, aucun ne se revendique d’un système qui les a pourtant portés là où ils sont. En témoigne leur carrière faite dans les rails les plus classiques de la République. François Fillon, après avoir obtenu un DEA de droit, devient à 22 ans assistant parlementaire du député gaulliste Joël Le Theule, l’année suivante chef-adjoint de cabinet de son député devenu ministre, puis entre au cabinet d’un autre ministre tout en se faisant élire conseiller général. Ensuite, depuis l’âge de 27 ans, il sera député, président de conseil général, ministre, premier ministre.
Benoît Hamon, après avoir obtenu une licence en histoire, est président des Jeunes socialistes à 26 ans. Il sera ensuite conseiller régional, député, ministre et député européen. Marine Le Pen, après avoir obtenu un DEA de droit comme François Fillon puis son CAPA d’avocat, est élue à l’âge de 30 ans conseillère régionale d’abord d’Ile-de-France, puis du Nord-Pas-de-Calais. Elle est également conseillère municipale et députée européenne.
Jean-Luc Mélenchon, après avoir obtenu une licence de philosophie, sera brièvement enseignant. A 32 ans, il est élu conseiller municipal, deux ans après conseiller général, et l’année suivante sénateur, poste qu’il occupera pendant près de 19 ans. Président délégué de conseil général, il sera également ministre et député européen.
Tous ces candidats ont donc étudié dans de bonnes universités, sont élus depuis leur plus jeune âge, se sont faits parachutés dans des régions électorales les plus favorables et ont cumulé les mandats. Deux d’entre eux ont en plus des problèmes avec la justice, liés à leur mandat électif. Tout cela n’est pas vraiment un gage d’antisystème.
Emmanuel Macron, qui n’a que 39 ans, est le seul à ne pas avoir occupé de mandat électif. Il a de plus démissionné de la fonction publique et plus précisément du corps le plus prestigieux, celui de l’inspection générale des finances, sans y être nullement obligé. Il a même remboursé 54 000 euros à l’Etat à qui il devait encore quatre ans de service. Il reste cependant un bon produit du système républicain, diplômé de l’ENA, banquier d’affaires chez Rothschild, secrétaire adjoint de l’Elysée, puis ministre.
Pourquoi alors mettre une telle obstination à se présenter devant les Français comme antisystème ? Sans doute parce que ça n’engage pas à grand-chose et propose comme remède à une société qui se vit mal, de changer, sans dire ce que l’on va changer. Pourtant, si l’on se réfère au seul système politique, des solutions facilement réalisables sont depuis longtemps dans le débat : supprimer tout cumul de mandat, limiter les mandats dans le temps, rendre transparent et donc public, les agendas des élus et des gouvernants, leurs rémunérations et leurs avantages, supprimer les indemnités ou frais qui ne sont pas soumis à contrôle et à justifications, rendre au parlement ses prérogatives constitutionnelles (par exemple le gouvernement qui est redevable devant le parlement n’a pas à démissionner lors de l’élection présidentielle) et son devoir de contrôle de l’exécutif. Déjà un lourd programme, efficace, et pas du tout antisystème.
Populisme. Populisme n’a pas, en France, un sens positif. Il est synonyme de démagogie. Pour un candidat, il s’apparente à un électoralisme forcené : je vous dis ce que vous voulez entendre pour me faire élire, une fois élu je ferais ce que je voudrais. Les candidats de l’extrême-droite, depuis Pierre Poujade qui porta à l’Assemblée en 1956 Jean-Marie Le Pen, sont les plus régulièrement accusés de populisme par leurs adversaires. La philosophe belge Chantal Mouffe, soutien et inspiratrice de Jean-Luc Mélenchon, tente cependant d’introduire une autre définition du populisme. Elle distingue d’abord un « populisme de droite » d’un « populisme de gauche ». Dans Le Monde du 19 avril, elle précise : le premier est « de type autoritaire et veut restreindre la démocratie aux nationaux », le second au contraire souhaite étendre la démocratie. Ce « populisme de gauche » permettrait de créer « une volonté collective, un « nous » qui cristallise des affects communs et les mobilisent dans la direction d’un approfondissement de la démocratie ». Tout en récusant le terme de « populisme de gauche », l’historien communiste Roger Martelli, qui tenait un débat avec Chantal Mouffe en septembre dernier à Toulouse, lui donne raison sur trois points : « il faut casser l’idéologie dominante du consensus qui englue nos sociétés », « il faut battre politiquement la logique libérale qui a tétanisé la gauche » et « il faut remobiliser les catégories populaires afin de leur donner accès à une pleine souveraineté ».
Distinction que ne reconnaît pas Eric Fassin, professeur de sciences politiques à Paris VIII, dans son dernier livre Populisme : le grand ressentiment. Le sociologue tient pour toujours actuelle la distinction entre droite et gauche et le populisme se situe ailleurs « en amont » de ce clivage. Le populisme de gauche est, pour lui, une aberration de l’esprit. Le mot même joue de son ambiguïté quant à la définition que l’on donne du peuple : « s’agit-il du peuple dans sa totalité ou en tant que classe sociale ? » demande Eric Fassin pour qui « il y a des classes différentes aux intérêts distincts, et il faut les faire converger pour construire un peuple ». Albert Ogien, directeur de recherche émérite au CNRS, est du même avis. Dans une chronique pour Libération du 18 mars, le sociologue note qu’en l’absence d’objet à la « passion politique » qu’appelle Chantal Mouffe, « le « populisme de gauche » se résume à une démarche : attiser des sentiments d’hostilité et de vengeance envers un ennemi afin d’en tirer un bénéfice électoral dont on ne sait à quelle fin il servira, mis à part l’accession au pouvoir de ceux dont l’objectif est d’électriser les foules pour y parvenir ». Comme Eric Fassin, il oppose « le respect des mécanismes de concertation, qui obligent à établir un dialogue et une base d’accord entre partenaires », base de notre démocratie et « l’engagement dans un affrontement « agonistique » afin d’imposer une « nouvelle hégémonie » selon les mots de Chantal Mouffe.
Nationalisme. Qu’une vague nationaliste balaie le monde est un constat à peu près unanime. Vient-elle après une vague mondialiste qui, depuis les années 80, aurait couvert ce même monde ? L’Amérique de Donald Trump pour qui le programme se résume à un seul slogan « Make America great again », la Chine de Xi Jinping ou la Russie de Vladimir Poutine qui multiplient les campagnes nationalistes montrent que les grandes puissances sont les premières à jouer de cette fibre. En Europe, d’autres Etats ont vu depuis le début du siècle, des politiciens nationalistes emporter les élections, comme la Hongrie de Viktor Orban, ou la Pologne des frères Kaczynski, la Croatie ou la Turquie d’Erdogan. Plus récemment, le référendum britannique pour le Brexit a été l’occasion de belles envolées nationalistes de ses partisans.
La France, et plus largement l’Union européenne, serait donc cernée par les nationalismes et n’aurait d’autre choix que d’y souscrire à son tour pour se protéger ? C’est un des enjeux des élections présidentielles, et l’une des marques de séparation les plus nettes entre les candidats. Les partisans d’un renforcement de l’Europe sont aussi ceux qui redoutent un nationalisme qui, dans l’histoire, a toujours été porteur de guerres et de récessions. C’est d’ailleurs le nationalisme qui est à l’origine de la dernière guerre sur le sol européen entre Croates, Serbes et Bosniaques.
Un des philosophes les plus reconnus et les plus respectés de notre époque, l’allemand Jürgen Habermas, dénonce depuis des années ce « retour des nationalismes ». Dans son livre La Constitution de l’Europe, il plaide pour un élargissement des compétences européennes, notamment en matière de fiscalité et de gouvernance économique et sociale, mais dénonce également « la désespérante foire d’empoigne qu’est le Conseil européen » où la solidarité n’est plus de mise. Il en appelle également au citoyen européen qui, « dans son for intérieur » doit gérer deux intérêts nécessaires mais rendus souvent antagoniques par les gouvernants en mal d’excuses : la souveraineté européenne et la souveraineté nationale.
La Constitution de l’Europe, de Jürgen Habermas, Editions Gallimard. Populisme : le grand ressentiment, d’Eric Fassin. Editions Textuel. L’illusion du consensus, de Chantal Mouffe. Editions Albin Michel

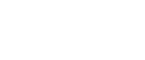 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
