Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Olivier Saksik, passion d’artistes
Son nom n’est pas à l’affiche. Il ne vient pas saluer avec artistes et techniciens lorsque la représentation est terminée. Il n’est ni un rouage, ni une de ces petites mains sans lesquelles aucune production ne voit le jour. Spectatrices et spectateurs ignorent le plus souvent son existence et, s’ils la connaissent, c’est sans bien savoir en quoi consiste son métier. Olivier Saksik est cependant indispensable aux productions qu’il soutient. Pour nous, journalistes, il est la perle rare par laquelle notre travail commence. Pour les producteurs de spectacle, metteurs en scène et directeurs de salles, c’est un porte-voix bien plus intelligent que l’artificielle. « De la rigueur, passionné, gros bosseur, on peut le joindre 24h sur 24 » dit de lui Laurence de Magalhaes, co-directrice du Théâtre du Rond Point et ancienne du Monfort.
« Un festival de jonglage ? ». Dès le lycée, Olivier opte pour une option théâtre, appétence qui ne se démentira plus pour les arts vivants. Logiquement le jeune Parisien s’oriente vers des études dans le même domaine au centre universitaire de Censier. Il suit avec application le cursus universitaire, et en parallèle les cours de cinéma d’Eric Mézil, longtemps directeur de la Collection Lambert Avignon. Mais il « s’ennuie beaucoup à la fac ». Lorsqu’il entreprend un stage en administration au Théâtre 71 de Malakoff, c’est une autre réalité qu’il découvre, celle de la création, plus vivante, plus passionnante, forcément déroutante. Ses yeux sont grand ouverts, son plaisir non simulé. L’ambiance le séduit, mais lorsque, en 1997, la secrétaire générale Agnès Célérier lui propose de rester pour une mission nouvelle, il est un peu désappointé. « Un festival de jonglage ? Je voyais pas trop… ». C’est que l’art circassien fait sa mutation. Un homme, génie de la balle et poète accompli, y concourt grandement. L’idée du festival Dans la jongle des villes, ça vient de lui.
La rencontre avec Jérôme Thomas. Jérôme Thomas en est à ses débuts d’auteur de cirque le plus inventif du métier de jongleur, avec son premier solo Extraballe, puis 4, qu’on en finisse une bonne fois pour toutes avec (1997), une pièce chorégraphiée fondatrice. Avec lui, Olivier fait ses premières gammes. « Ce qui est important dans notre rencontre c’est que nous avions chacun un chemin à faire, avec l’idée qu’on est attentif et sensible au chemin de l’autre, indépendamment d’une actualité et considérant que sur un parcours il peut y avoir des hauts et des bas » dit de lui Jérôme Thomas. « Agnès, Olivier et moi-même avions la conviction qu’on était en train de vivre quelque chose d’extraordinaire, un moment de l’histoire de l’art. On était en train de faire quelque chose qui n’avait jamais été fait. Avec un désir très fort que ce soit partagé. Notre relation est née comme ça. »
Olivier multiplie ensuite les stages, au théâtre de la Tempête avec Philippe Adrien, à l’Odéon parisien… Aux relations publiques du Théâtre Paris-Villette, il est d’abord chargé de la médiatisation des représentations faites dans les appartements. Lorsque, dans le cadre d’un partenariat avec MK2 qui vient d’ouvrir ses deux cinémas de part et d’autre du canal de l’Ourq, se pose la question de faire venir des spectateurs parisiens pour qui le temps de déplacement est une donnée non négligeable, Olivier lance une idée : « en bateau ». Le public apprécie. Ça marche !
Au bout de trois ans, le travail devient répétitif pour un jeune homme qui a soif de tout. Mais il a signé un contrat à durée indéterminée. Dans ce milieu où l’intermittence règne, c’est une chance et l’on y regarde à sept fois avant de démissionner. La tentation est pourtant trop forte lorsque Agnès Célérier, qui dirige alors la Cie Jérôme Thomas, lui propose de rejoindre la compagnie du jongleur qui s’installe Parc de la Villette. C’est en octobre 2001. « Je le fais ».
La relation presse. La décision va modifier sa vie et façonner son itinéraire professionnel. Il s’occupe d’organiser les nombreuses demandes d’interviews en faisant venir toute la presse à La Villette. Les arts circassiens connaissent alors une nouvelle ère avec de grandes machines comme le Cirque Plume ou le Cirque du soleil. Un jongleur-poète, c’est différent. Par chance, 2002 est consacrée Année des arts du cirque, et pour Olivier le travail de relations presse se confirme. Le Monde, quotidien sublimé dans ce milieu, veut faire un article sur le renouveau du jonglage et il convainc la journaliste de présenter Jérôme Thomas en fer de lance. Comme toujours, il s’engage à fond, jusqu’à participer à une MasterClass de jonglage... Olivier accompagnera pendant vingt-quatre ans une douzaine de créations de Jérôme et des projets insolites comme l’atelier ICI, mené en milieu carcéral. Avec le tempo qu’exige la création.
« Il y a dans le métier des gens qui veulent aller plus vite que la musique, qui s’affranchissent du rapport au mouvement artistique, qui pensent que c’est une prestation, explique Jérôme Thomas. Olivier a eu aussi des désenchantements en s’engageant trop vite ou trop tôt avec certaines équipes artistiques ou théâtres qui considéraient qu’il n’y avait pas assez de retour sur investissement. Il a vécu des déconvenues. Il faut être solidaire entre attaché de presse et artiste. La confiance et la longévité doivent l’emporter dans cette relation. »
Et Olivier créa Élektronlibre. Toujours animé du plaisir de partager les créations en train de se construire, il sent son appétit grandir. « Jérôme Thomas m’a amené vers des structures comme Aubervilliers, Malakoff, le CIRCA ». Mais pour diversifier les compagnies, les festivals, les institutions qui lui demandent ensuite de les accompagner, « il faut se lancer seul ». Élektronlibre, son agence de relations presse, naît en 2001. Sa manière de travailler est reconnue, il sait affirmer « énormément d’ambition » pour les gens pour qui il travaille, mais également un positionnement engagé : « ce qui m’importe, c’est de ne pas être considéré comme un prestataire de service, mais comme faisant partie de l’équipe ».
Celles et ceux qui le fréquentent connaissent cet engagement fort pour les projets, les artistes et les institutions qu’il accompagne. Inlassablement, il assiste aux répétitions, voit les spectacles plutôt six fois qu’une, suit leur évolution. Vous le croisez à Paris sur les sièges d’un théâtre labellisé, il est à nouveau assis près de vous quelques mois après pour ce même spectacle parti en tournée dans un festival prestigieux, ou sur une scène des Vosges ou de Charente. Entre temps, il aura suivi maintes représentations. Père de trois enfants qui doivent se passer de lui au moins les trois soirs par semaine où il s’assoit dans les gradins, il saisit ce qui le passionne, l’évolution d’un spectacle qui n’est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.
Il fait souvent plus. Et avec gourmandise. L’un de ses plus beaux souvenirs ? Le spectacle Ceux qui restent, que David Lescot crée en 2013 au Monfort sur les rescapés de la Shoah. « J’ai proposé à une poignée de journalistes de revivre l’histoire de ce spectacle à l’occasion de la commémoration des soixante-dix ans du soulèvement du ghetto de Varsovie ». Séduite par la proposition, Stéphanie Fromentin, alors journaliste à France Inter, ne sait cependant pas trop comment la mettre en musique. Avec la rédaction de l’émission Interception, le projet se précise. Pourquoi ne pas partir ensemble à Varsovie pour enregistrer deux témoins encore vivants du soulèvement du ghetto, Paul Felenbok et Wlodka Blit-Robertson dont les familles furent cachées dans le même immeuble ? Témoins qui ont inspiré David Lescot. C’est un succès, public et médiatique, pour la pièce comme pour l’émission de la radio publique.
Aussi discret que prévenant, il connaît les réalisations et les projets de ce monde effervescent. Il s’intéresse moyennement aux anecdotes et aux ragots, mais est intarissable sur les créations elles-mêmes, toujours complice des artistes. Il les vend. Pas en numéraire. En contenus, en surprises, en émerveillements. S’il a un regret, c’est d’avoir vu des représentations ne pas être accueillies comme il pensait qu’elles le méritaient.
« Aujourd’hui il est davantage dans la découverte d’artistes », dit encore de lui Laurence de Magalhaes. Tout en continuant à accompagner Cyril Teste et Jacques Vincey, le Studio-ESCA d’Asnières et Artcena, la maison Maria Casarès ou le Théâtre de la Concorde.
Le temps suspendu du Covid aurait pu être une épreuve pour son entreprise. Il l’a été, mais pas seulement. « Ce que j’ai aimé à cette période, c’est la cohésion, la solidarité du milieu des arts vivants. Et puis cette façon de se saisir de cet autre rythme pour réfléchir et penser autrement ». Un « penser autrement » qui signe sa foi dans les arts vivants. Alors que les financements sont bousculés, il « ne voit pas l’avenir sans culture ». Foisonnante, multiple, la création artistique ne faiblit pas. Lui non plus.

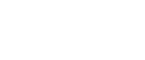 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
