Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Laaroussa Quartet honore la gestuelle des potières de Sejnane
La découverte dans la vitrine d’une galerie parisienne d’une poupée de Sejnane a provoqué un séisme dans l’esprit de Selma Ouissi. En prenant conscience de la disparité entre le prix de vente « mirobolant » de l’objet et la précarité des femmes qui le fabriquent dans cette région de Tunisie « j’ai été saisie par un sentiment d’injustice. Sejnane est l’un des territoires les plus pauvres de la Tunisie ». L’image de ces femmes vendant leurs œuvres au bord des routes à un prix dérisoire, leurs gestes préservant un savoir-faire vieux de trois mille ans qu’elles transmettent à leurs filles, a poussé Selma et Sofiane à faire le voyage en 2011 jusqu’à ce territoire du nord de la Tunisie.
Une tradition millénaire. Une vidéo projetée sur l’immense écran occupant le fond de scène immerge quatre comédiennes de plusieurs générations, une violoniste et une vieille femme coiffée d’un fichu, assise sur une chaise. Autant de femmes témoins et interprètes d'une tradition millénaire. Dans les pas d’une potière, s’emboitent ceux de Selma et Sofiane Ouissi. Le chemin jusqu’à Sejnane est long et difficile. À leur arrivée, une porte s’ouvre, le visage d’une femme les accueille. Au fil de la vidéo, des dizaines de femmes se retrouvent dans le hangar agricole qui jouxte la pauvre maison. Toutes potières, elles viennent d’autres hameaux, s’embrassent. Ce sont elles qui façonnent les poupées d’argile, appelées laaroussa (qui signifie en dialecte tunisien la poupée et la mariée). Laaroussa représente le symbole de féminité, de force et de fertilité des femmes potières…
Sur scène, les femmes s’assoient, à deux, à trois, face à une liasse de grande feuilles blanches sur lesquelles elles suivent les indications des gestes rituels de la fabrication des Laaroussa. Sur l’écran, les mains des potières, maniant la pioche, extirpent en gestes mesurés l’argile du sol. Plus tard, ces mêmes mains brisent les blocs de terre, puis les écrasent avant de les tamiser. Du façonnage on ne voit en gros plan les doigts, l’argile mouillée, enfin le feu cuisant un grand corps de terre peinte.
Jamais on ne verra une poupée dans son entièreté. L’objet de Laaroussa Quartet n’est pas là. Il est dans les mains et le visage de ces femmes, à la fois fermières et potières, dans le rythme et la répétition de leurs gestes millénaires et symboliques, dans la simplicité, voire le dénuement, de leurs existences. Les sons composés au violon par Asha Orazbayeva n'apportent pas la sophistication. Ils accompagnent, comme un souffle inédit, les gestes saccadés des femmes assises sur la scène de la Fabrica et, à l'écran, les femmes de Sejnane qu’on voit se retrouver, travailler, caresser le visage d’une autre de leurs mains puissantes, se parler assises dans le hangar, leurs tissus colorés formant une humanité solide comme la terre.
Le dispositif scénique annule la distance entre ici et là-bas. Le silence du façonnage, l’énergie nécessaire est ici aussi, dans les gestes et les corps.
Laaroussa Quartet, Conception, dramaturgie et chorégraphie Selma et Sofiane Ouissi. Avec Amanda Barrio Charmelo, Sondos Belhassen, Marina Delicado, Moya Michael, Chedlia Saïdani, Aisha Orazbayeva.
Les 6, 7 et 8 juillet à 19h à La Fabrica dans le cadre de la 79e édition du Festival d'Avignon.

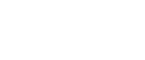 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e


