Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Tamara Al Saadi : « Mes obsessions artistiques, l’enfance et le silence »
Vous créez cette année TAIRE, une commande du théâtre Dijon Bourgogne, que vous définissez comme une réécriture d’Antigone pour vous intéresser au silence des enfants, à leurs voix confisquées par les adultes. Pourquoi ?
Initialement le spectacle avait pour terrain de recherches Ramallah et Gaza, j’étais en lien avec l’Institut Français de Jérusalem et celui de Gaza. C’était en 2022. L’idée était de faire des ateliers là-bas autour d’Antigone, avec une certaine tranche d’âge en Palestine. Ensuite de faire des ateliers équivalents dans des espaces périphériques en France avec cette tranche d’âge. D'un côté une jeunesse sous occupation coloniale, de l'autre une jeunesse qui, dans un pays occidental, subit les travers du colonialisme, en est l’héritière. Il s’agissait de questionner et de voir où se situe l’endroit de révolte et de résistance, où sont les priorités maintenant, et comment leur parle ce mythe de la jeunesse révoltée. Enfin de voir les convergences et les différences.
Mais vous n'avez pas pu mener ce travail…
Il y eut le drame du 7 octobre, l’université avec laquelle je travaillais a été détruite et certains de mes interlocuteurs sont décédés. J’étais dans un état de sidération, je voulais arrêter le théâtre, tout arrêter. Je me suis alors souvenu que j’ai rencontré Antigone au collège, à quatorze ans, j’avais fait une tentative de suicide. Or je retrouvais cette sensation de violence et de sidération. Je me suis dit qu’il faut peut-être faire confiance au mythe à l'endroit où je l'ai rencontré. Du coup je me suis retournée vers cette adolescence brisée, vécue à l'hôpital en pédopsychiatrie.
Vous avez alors fait des ateliers dans des services de pédopsychiatrie, avec Antigone…
Oui, et c’est là que j’ai rencontré la réalité des enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ça m’a menée à l’épicentre d’une crise humanitaire sur le sol français. Cette crise humanitaire des enfants m’a ramenée en Palestine et le miroir s’est repositionné autrement. Je déplie le parcours d’Éden et celui d’Antigone à l’orée d’une métaphore de l’occupation israélienne. J’ai mis en parallèle mes deux enfances réduites au silence. En réfléchissant au titre, TAIRE, j’ai appris que l’étymologie d’enfance c’est infans (celui qui ne parle pas). Tout s’est rencontré.
La violence est moteur de votre esthétique. Comment intervient-elle dans votre création ?
Cela dépend des situations. Dans Istiklal, il y a un féminicide. Je me suis dit les chiffres ça suffit, il faut montrer. Je me suis demandé comment le montrer de façon que ce soit recevable tout en ayant la force émotionnelle. C’est mon travail de metteure en scène. J’ai travaillé avec la lumière, avec le texte, le dispositif, une chorégraphie très précise de strangulation, un travail du son, le poids du corps qui tombe, on comprend qu’un enfant regarde. Plusieurs paramètres convergent pour créer un point de tension insoutenable sans montrer du sang.
Dans d’autres situations ce sont des paroles qui sont rapportées. En fait je ne peux pas aborder les sujets que j’aborde sans parler de la violence. Donc il faut à chaque fois la retranscrire de la façon la plus équilibrée, sans complaisance mais en prenant soin du spectateur. J’implique aussi les spectateurs. Dans Partie par exemple je les rends complices.
Votre pièce Place développe le sentiment de n’être jamais à sa place quand on est né dans un autre pays que celui dans lequel on vit. Comment en faire une force artistique ?
J’ai voulu traduire ce que j’avais compris. Réalisant ce qu’est l’assimilation, en quoi elle est une colonisation culturelle de l’intime, qu’intégration et assimilation ne sont pas la même chose, sont même des concepts opposés. L’intégration est pour moi une reconnaissance mutuelle alors que l’assimilation est une culture qui en interdit une autre. Cette aliénation de l’intime chez l’enfant est ravageuse.
Mes obsessions artistiques sont l’enfance et le silence. L’aliénation de l’enfant, comment il sera adulte, cela apparaît dans tous mes spectacles. Je suis née en pleine guerre, avec un père en prison, une famille très dysfonctionnelle, de la violence sourde, psychologique. Pour survivre, j’étais obligée d’imaginer et de sublimer les gens. J’ai créé un espace autour de moi pour le rendre possible. Cette faculté développée pour survivre, où je métabolise les drames en espoir, je me suis rendu compte que je fais ça dans toutes mes pièces. C’est un fonctionnement très intime.
Je sens que mon système de sublimation est en train de s’effondrer. C’est peut-être le moment de la désillusion. Je crois que je n’écrirai plus jamais pareil parce que je n’ai plus le même filtre de perception. Mes pièces ce sont des montagnes russes émotionnelles, mais je ne laisse pas partir les spectateurs sur quelque chose de violent.
Vous dites qu’être arabe est problématique. Vous vous définissez comme une artiste racisée, vous évoquez une jeunesse racisée, qu’est-ce que ça dit de la société ?
Qu’est-ce que vivre en étant racisée ? Dire seulement le mot c’est gênant pour beaucoup. Pourquoi tu dis ça ? Je suis très étonnée quand les gens rejettent le mot racisme. La race est un concept, mais cette fiction a un impact sur l’architecture sociale. Il y a une réaction très républicaine : pourquoi tu dis racisé ? Il n’y a pas de races, c’est violent ! Je réponds : mais tu utilises bien le mot raciste ! Donc il y a des racistes mais pas de racisés ? En me confisquant ce mot tu contribues à l’invisibilisation. Je pense que c’est le drame de notre société.
Tout le monde dit que le racisme c’est très grave, c’est un mot tabou, même le RN s’en dédie. C’est comme une patate chaude dont personne ne veut. Mais à partir du moment où des personnes disent qu’elles en sont victimes, c’est un scandale. Avec Place, un directeur de lieu m’a accusée de racisme anti blanc. Le fait de rendre visible le racisme met tout le monde mal à l’aise. Il faut lutter contre le racisme mais surtout ne pas le montrer. De la même manière il faut lutter contre l’inceste mais surtout pas le montrer. Certaines personnes m’ont dit que mon spectacle MER est scandaleux, toxique. Il faut lutter contre les violences faites aux enfants mais il ne faut surtout ne pas en parler. Il y a un mouvement qui fait que quand les oppressions exercées par les dominants sont dévoilées, racontées, c’est un scandale.
Auteure, comédienne et metteure en scène, Tamara Al Saadi est née en Irak et arrive à Paris à l’âge de quatre ans, d’abord en vacances, puis en exil car la guerre Iran-Irak éclate au même moment. Formée au métier de comédienne à l’École du jeu et en Arts et Politique à Science Po Paris sous la direction de Bruno Latour.

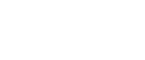 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
