Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Rivesaltes, un mémorial comme lieu de conscience citoyenne
C’est le dixième anniversaire du mémorial de Rivesaltes. Le camp militaire de Rivesaltes a été utilisé par l’État français comme lieu de rétention entre 1941 et 1942, de 1945 à 1948 et de 1962 à 1966. Républicains espagnols, Juifs étrangers, Nomades, constituent l’essentiel de la population qui y a été enfermée. Après la Libération, il fut un important camp de prisonniers de guerre allemands. Il sert de prison pour les combattants du FLN après l’indépendance de l’Algérie, avant de devenir le principal « centre de transit » pour les harkis, jusqu’en 1964. Des militaires guinéens, malgaches et vietnamiens y sont ensuite démobilisés. Au total plus de 60 000 personnes sont passées par le camp de Rivesaltes et sans une lutte citoyenne qui dura plus de vingt ans, la mémoire du site aurait été enfouie parmi les ruines des baraquements disséminés sur une petite surface d’une plaine immense, aride et désolée, des Pyrénées orientales. Éloigné de tous les regards, idéal pour y enfermer les individus considérés comme « indésirables ».
La nécessité d’un mémorial s’est imposée, et il a trouvé sa forme en 2015 avec l’équipe de l’architecte Rudy Ricciotti. Construites sous terre, sans emprise sur le paysage, ses salles sont accessibles par un long couloir obscur. Le mémorial exerce une singularité à la fois humble et audacieuse.
Le mémorial comme lieu de conscience. « Quand il a ouvert en 2015, ce mémorial n'était pas simplement un bâtiment au milieu des baraquements. Il était un pari. Un pari pour que ce lieu de violence administrative, d'absurdité bureaucratique, puisse devenir un lieu de pensée, un lieu de conscience » rappelle Céline Sala-Pons, directrice du site. Depuis, le mémorial ne s’est jamais refermé sur lui-même. Sans cesse enrichi des dernières découvertes et études scientifiques, il est devenu un lieu d’ouverture et de dialogue. Et, chose rare, aujourd’hui la moitié de son public a moins de 18 ans.
Témoin du « désastre de la violence administrative et de la discrimination de populations indésirables », le mémorial est un lieu nécessaire « dont la visite enseigne la noirceur et la cruauté de l’exclusion aléatoire, comme un contre point aux tentations politiques qui s’affirment de plus en plus en Europe. » affirme Céline Sala-Pons.
Ni tristesse, ni de solennité écrasante pourtant dans ce mémorial. La mémoire y est bien vivante, le travail de transmission est au cœur du projet, même s’il faut faire face à la disparition des témoins. Or rendre visible le traitement réservé aux raflés passe par eux, engage, « nous donne à comprendre, nous aide à agir en responsabilité » souligne la directrice du lieu. Pionniers, historiens, scientifiques, descendants ont beaucoup à transmettre aux générations suivantes. Les documents, les rencontres, les colloques, les objets et les photographies exhumées racontent. Les artistes invités transforment les silences.
Faire face à la disparition des témoins. « Aujourd'hui, ce mémorial est un lieu qui compte dans le paysage mémoriel français et européen. C'est une voie rigoureuse, c'est une voie scientifique. C'est aussi une voix culturelle, parfois dérangeante mais c'est une voix qui interroge. Comment aujourd'hui transmettre la mémoire avec les témoins qui disparaissent. Voilà une de mes missions centrales » affirme Céline Sala Pons. Tant par sa durée que par le nombre de personnes internées, reléguées, le mémorial de Rivesaltes est considéré comme l’un des plus grands d’Europe occidentale et il rend compte des conflits de la seconde moitié du XXe siècle. Alors que les exils forcés de population, les effets de la décolonisation, la montée de l’antisémitisme, la chasse aux indésirables sont plus que jamais d’actualité, le lieu a un rôle à jouer dans la construction des consciences et des résistances. Depuis l’origine un conseil scientifique est associé à la destinée du mémorial, désormais inscrit dans les réseaux transfrontaliers et européens de la recherche. Les partenariats avec les universités se sont renforcés, chercheurs et étudiants sont régulièrement accueillis. Le mémorial s’est également investi dans la recherche didactique avec la création en 2023 d’un conseil pédagogique à l’origine de colloques et de publications.
Une refonte intégrale du parcours. Avec son dixième anniversaire, « l'acte 2» mémorial s’ouvre avec des engagements que sa directrice énonce. « Documenter : continuer à archiver le présent pour demain parce que la mémoire ce n'est pas une nostalgie, c'est une matière vivante et c'est aussi un futur en construction. Transmettre : redoubler d'efforts pour porter cette histoire dans les écoles, dans les universités, dans les médias et faire de Rivesaltes un lieu ressource pour la jeunesse, pour l'éducation citoyenne mais aussi pour la démocratie ». Afin d'amplifier et de rendre plus visibles et accessibles ces engagements, de grands travaux sont programmés pour créer un nouveau parcours de l'exposition permanente, enrichi de nouveaux contenus. Pour un montant de plus de 2,6 M€, sous la maîtrise d'ouvrage de la Région Occitanie et avec le soutien de l'Europe, les travaux devraient s'achever au printemps 2026.
Rester en prise directe avec les urgences du présent. Qu'est-ce que Rivesaltes nous enseigne aujourd'hui en 2025 ? C’est avec cette question que, lors de la grande fête anniversaire du 18 octobre, s'est ouvert le champ de la recherche au mémorial. En répondant à l’invitation de l’université de Barcelone en septembre à l’occasion d’un colloque international, Céline Sala Pons avait précisé dans sa conférence les nouvelles perspectives du mémorial, liées à la refonte intégrale de sa scénographie. Sous le titre, Rivesaltes, la transformation d’un lieu de mémoire en outil critique de notre présent commun, la directrice expliquait que le réaménagement technique et fonctionnel du mémorial devra se mettre au service du besoin impérieux de « revisiter ses fondements, ses usages, sa vocation politique et éducative, dans un contexte européen marqué par l’érosion des repères démocratiques, la montée des radicalismes, et la résurgence de discours négationnistes ou relativistes sur les violences du passé » pour « réinterroger les modalités de transmission » après dix années d’accueil des scolaires et du grand public. La refonte scénographique prévoit des parcours différenciés (général, jeune public, citoyen), des textes en langage simplifié, en plusieurs langues, une diversification des formats (audio, vidéo, manipulation d’objets) et un espace de médiation dédié, pour accompagner les publics dans leur parcours. « Plus qu’un musée, le Mémorial devient ainsi un atelier de citoyenneté, un lieu d’apprentissage de la complexité, où l’histoire est un levier de vigilance face aux discours de haine, de rejet ou de simplification qui menacent nos sociétés. »
ENTRETIEN AVEC CÉLINE SALA-PONS RIVESALTES, CAMP D'INTERNEMENT DES FAMILLES NOMADES LES NOMADES, UNE AMNÉSIE COLLECTIVE

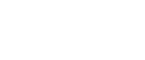 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e



