Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Bowie : Le dernier avatar
Entrer dans un album de David Bowie n’est pas toujours chose simple, c’est pénétrer dans un univers complexe dont lui seul a la clef. Blackstar, le 27e album studio de l’artiste, édité le 8 janvier dernier, le jour de son 69e anniversaire, ne déroge pas à la règle. On le ressent sombre et crépusculaire. Si on avait su, on l’aurait immédiatement perçu comme annonciateur d’une triste nouvelle, celle de sa disparition survenue trois jours plus tard : Blackstar, avec sur la pochette une étoile noire sur fond blanc, avec à ses pieds des débris d’étoiles noires, un CD testament. Mais avant de partir, Bowie fait une nouvelle fois la preuve de son génie, celui qui lui a valu le surnom de « caméléon », avec cette capacité à toujours renouveler son style musical, à se réinventer.
Des musiciens de jazz. Cette fois, c’est à quelques-uns des plus talentueux jazzmen de la scène new-yorkaise qu’il a fait appel. Ce n'est pas pour produire un album jazzy, mais pour mêler les influences, entraîner dans les directions qu’il a choisi le saxophone de Donny Mc-Caslin, la guitare de Ben Monder, le clavier de Jason Linder, la basse de Tim Lefebvre ou encore les percussions de Mark Guiliana. Autant de musiciens de jazz contemporain à l’apogée de leur art, qui donnent du relief à cet album et soulignent la signature Bowie.
Certains critiques qui ont pu écouter quelques extraits avant parution n’ont pas hésité à parler « d’album expérimental ». En tout cas le presque septuagénaire innove encore avec un album étrange qui restera désormais, la dernière de ses œuvres. Sept titres, pour un peu plus de 40 minutes d’écoute, avec une chanson titre ouvrant l’album durant dix minutes qui, à elle seule annonce la couleur : ambiance sombre et minimaliste portée par la batterie, le sax et la voix languissante d’un Bowie hésitant entre un style lunaire et une tendance plus mélodique. Le texte n’est guère réjouissant, il y raconte avec des intonations orientales, un jour d’exécution publique sous le sourire des femmes au « village d’Omen ». Omen, comme présage en latin, encore une évocation de la fin proche. Suit Tis a pity she was a whore (quel dommage que ce soit une pute) un titre qui n’est sans doute pas d’une grande élégance mais dans lequel le chanteur lance son band à fond la caisse, sur un rythme allant crescendo pour une montée en puissance pop-rock version formation cuivres, clavier, percussions, basse.
Avec Sue (Or in a season of crime), Girl loves me, Dollar days, I can't give everything away, l’auteur poursuit sur sa lancée, jouant à la fois de l’atmosphère de Blackstar, de sa formation instrumentale, et d’un son Bowie moins éloigné des sentiers battus.
Lazarus désormais. Mais c’est avec Lazarus (Lazare), troisième morceau du CD, un extrait de la comédie musicale éponyme coécrite par David Bowie et jouée à New York depuis le mois de décembre, que l’artiste retrouve sa pleine démesure. Avec ce titre aux relents plus rock, le chanteur se réinvente encore. On a connu le flamboyant Ziggy Stardust, le sidéral Major Tom, le dandy Thin White ou encore le blafard Pierrot, ces personnages dont il dessinait lui-même les costumes, ou plutôt ces avatars avec lesquels il a traversé depuis près de 50 ans toutes les époques, toutes les modes ; ces autres lui-même, déroutants, qui ont accompagné chacune de ses métamorphoses musicales et vestimentaires, et qui donnent tant de fil à retordre, dès lors qu’on voudrait l’enfermer dans une style précis.
Lazarus sera donc le dernier de ces personnages. Une mise en scène jusqu’au bout, jusqu’à la mort dont il aura aussi dessiné l’esthétique. Dans le clip qui l’accompagne, on le voit couché sur un lit d’hôpital, les cheveux blancs dressés sur la tête, les yeux recouverts de bandelettes, le visage émacié et pâle. « Regarde je suis au paradis, j’ai des cicatrices qui ne peuvent être vues », chante-t-il, avant de s’enfoncer dans une armoire noire, dont les portes se referment comme le couvercle d'un cercueil.

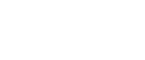 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
