Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?La Cour d’honneur face aux Damnés
En 1969, lorsque Lucchino Visconti sort Les Damnés, le film est une révélation. Visconti est déjà un des réalisateurs les plus respectés au monde lorsqu’il conçoit sa quadrilogie allemande, dont Les Damnés (La Caduta degli Dei) sur un scénario écrit avec son complice du Guépard Enrico Medioli et le journaliste Nicola Badalucco, est la première pièce. Tout Visconti est dans ce film. Il signe une esthétique unique qui façonnera celle d’une génération jusqu’à Fassbinder qui s’en revendique. Elle est née d’une combinaison fabuleuse entre une pensée artistique inédite, une culture aristocratique séculaire (les Visconti ont régné sur Milan), une éducation au réalisme cinématographique (Lucchino a été l’assistant de Renoir en 1936), une lutte contre le fascisme (il est membre du parti communiste italien), une pratique du néo-réalisme avec notamment Rossellini puis sa rupture dès 1954, avec Senso. Cette esthétique est un pan entier de l’histoire du cinéma, et de très nombreux spectateurs ont les images viscontiennes gravées dans le cerveau.
Le scénario, pas le film. C’est dire le défi que se lance Ivo van Hove, même si l’on se décharge de tout a priori en entrant dans la Cour d’honneur. Le metteur en scène belge insiste bien, il répète avec énergie qu’il n’a pas adapté le film, mais mis en scène le scénario. Il s’est saisi d’un matériau littéraire pour faire œuvre autre. Comme il l’a déjà fait avec Ludwig ou Rocco et ses frères du même Visconti.
L’histoire est celle de la déchéance d’une maison aristocratique et industrielle, les Essenbeck, pendant l’année qui va de l’incendie du Reichstag à la nuit des longs couteaux, c’est-à-dire la prise rapide et violente par Hitler de tous les pouvoirs. Ce qui intéresse Ivo van Hove dans ce script, c’est « la célébration du Mal », une problématique toujours actuelle où « la prospérité financière et le bien-être économique comptent davantage que le bonheur de l’humanité ». Ce « phénomène étrange, très particulier et très intéressant à observer et à décrire » est la matrice de son travail.
Pour le réaliser, pour répondre à ce pari audacieux, il est servi par des acteurs de choix, ceux de la Comédie-Française. Et dispose, avantage ou inconvénient, d’un plateau surdimensionné, celui de la Cour d’honneur où Olivier Py avait l’intention, pour cette 70e édition du festival, d’inviter et la troupe de la Comédie-Française qu’on n’y avait pas vue depuis 23 ans et un metteur en scène n’y ayant jamais travaillé.
Plateau réduit, passions concentrées. Ivo van Hove restructure d’abord le plateau. À gauche un espace surélevé où des chaises attendent les comédiens comme en coulisse, barrée par une ligne de loges qui délimite le rectangle de la scène. À droite et en symétrie, une ligne de chaises pour les saxophonistes du quatuor Bl!ndman (sax) et, en surélévation, sept cercueils. Le plateau ainsi réduit est encore balisé en fond par un immense écran, disposé face au public, exactement comme dans une salle de cinéma. Il est entouré de droite et de gauche par les vestiaires où les comédiens se changent, aidés des habilleuses. La Cour d’honneur remise au dimension d’un théâtre, les trompettes peuvent imposer le silence et la scène inaugurale accueillir le repas anniversaire du patriarche Joachim von Essenbeck (Didier Sandre ) où tous les acteurs se trouvent réunis. Le parti pris d’Ivo van Hove est ensuite d’une succession de tableaux où le drame se noue et s’achève par la mise en tombeau effective de la victime. Chaque tableau oppose deux ou trois membres de la maison Essenbeck souvent en présence, muette, suggestive ou dirigiste, du seul SS, le cousin Von Aschenbach. Scènes continuellement augmentées d’une prise de vue vidéo, le plus souvent en direct, projetée sur le grand écran.
Duos, trios et huis-clos. Le dispositif scénique complexe dépouille le script de toute sa séduction viscontienne, aussi bien celle effrayante que le nazisme exerce sur les masses et les individus, que celle nodale qui se joue dans le huis-clos du château familial. Il assure la distance entre l’avenir glacial qui se prépare et les passions humaines distordues par l’ambition. Servie pleinement par un jeu dépourvu de lyrisme, la mise en scène participe de cette tendance épique qui met directement le spectateur face à la dénonciation d’un monde. Il en résulte une certaine froideur. La nuit des longs couteaux, où les SS déciment les SA assommés par leur orgie, se résume au dialogue entre Konstantin von Essenbeck et son lieutenant SA, seuls présents sur scène alors qu’un kaléidoscope déshabille sur écran les corps des SA.
C’est dans cet espace nu, mais trop large encore, que s’affrontent et se meurtrissent ces passions assassines nées autant des humiliations familiales que du contexte historique. Elles se rétrécissent, aidées par les zooms de la caméra, pour dire en gros plan, plus que pour montrer, la pédophilie et le désir incestueux de Martin (Christophe Montenez) pour sa mère Sophie, la veulerie et l’arrivisme du directeur général des aciéries Friedrich Bruckmann (Guillaume Gallienne), l’aveuglement et le conservatisme de sa maîtresse, Sophie von Essenbeck (Elsa Lepoivre), le courage et le libéralisme du vice-président Herbert Thalmann (Loïc Corbery ) et de sa femme Elisabeth (Adeline d’Hermy), l’intelligence machiavélique du SS Aschenbach (Éric Génovèse), la stupidité arrogante du SA Konstantin von Essenbeck (Denis Podalydès).
Comparaison n’est pas raison. Ces contradictions, trop de pouvoirs, trop d’argents, trop d’amours consanguins, font le lit de la violence où le nazisme est maître. Obsédé par le réarmement de l’Allemagne qui, interdit par le traité de Versailles, ne peut se faire qu’avec la complicité active des industriels, le mouvement nazi sait pousser la violence à son paroxysme pour assurer peu à peu son pouvoir. Les documentaires d’époque nous le montrent, et empêchent tout anachronisme. Si pour conserver pouvoir et argent, de l’antiquité à nos jours, certains sont prêts à des révolutions réactionnaires qui finiront par les dévorer, l’histoire ne joue jamais deux fois la même partition. Et les passions humaines, poussées à leur point le plus irrationnel, peuvent se transformer en terrain de jeux et de manipulations pour les utopies grégaires les plus simplistes.
Visconti analyse un monde où la bête immonde s’est enfoncée au plus profond de sa tanière. Le château des Essenbeck est séduisant, comme dans un tout autre registre l’auberge bavaroise réservée pour l’orgie des SA. Le SS Aschenbach est attirant, et Martin dérangeant. Ivo van Hove est lui dans un monde où la tête de la bête se montre à nouveau. Cette seule idée fait froid dans le dos, il semble plus important de la combattre que de s’interroger sur ses séductions. Ce n’est pas affaire de sentiments. Mais comparaison n’est pas raison. Et cette dernière, Ivo van Hove l’interroge, les acteurs debout face au public. Est-elle suffisamment puissante pour contrer le crime attisé par les passions ?
Les Damnés, mis en scène par Ivo van Hove d’après le scénario de Luccino Visconti, Enrico Medioli et Nicola Badalucco. Cour d’honneur du Palais des papes, jusqu’au 16 juillet. Interprétée par les acteurs de la Comédie-Française : Didier Sandre, Denis Podalydès, Elsa Lepoivre, Guillaume Gallienne, Éric Génovèse, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Christophe Montenez, Clément Hervieu-Léger. Scénographie et lumière : Jan Versweyseld. Reprise à l’automne à la Comédie-Française du 24 septembre au 13 janvier 2017.

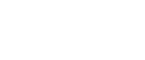 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
