Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Daniel Soutif : « The Color Line construit une visibilité qui n’existait pas »
Comment vous est venue l’idée de cette exposition ?
L'idée m’est venue pendant que je préparais l’exposition précédente dont j’étais le commissaire au Quai Branly en 2013, Le siècle du jazz. Comme beaucoup de gens de ma génération, j’étais devenu conscient de la culture noire américaine par le biais de la musique dans les années 50. La découverte du jazz fut une porte d’entrée, mais on avait très peu conscience des arts visuels. En 2005-2006, l’hypothèse de l’exposition était la relation entre le jazz et les arts visuels. A ce moment-là je pensais Matisse, Mondrian, Pollock… Je connaissais peu les artistes noirs et je n’avais pas du tout pensé qu’il allait falloir examiner Archibald J. Motley, Aaron Douglas et d’autres. En y travaillant, est apparu assez vite tout cet aspect d'une histoire américaine méconnue. J’ai alors chercher à intégrer cette découverte à l’exposition grâce au prêt de plusieurs œuvres, tout en me disant que si l’occasion se présentait je ferai une exposition consacrée aux sculpteurs et aux peintres noirs américains, de façon à les faire découvrir ici.
L'exposition The Color-Line aurait pu avoir sa place aux Etats-Unis…
Aux Etats-Unis, c’est différent. Depuis les années 70, beaucoup de travail a été fait sur les artistes en question, on a vu beaucoup de transformations. Le musée de Detroit a ouvert sa section africaine-américaine. Pendant la présidence Obama, les institutions, très pauvres en art africain, comme le MoMA, le Metropolitan, le Whitney, ont commencé à acheter et, ces deux dernières années, à faire des grandes expositions monographiques. L’une a été consacrée à Archibald Motley, une autre ouvre le 25 octobre au Metropolitan consacrée à Kerry James Marshall.
Les changements dont vous parlez aux Etats-Unis sont très récents, rien d’étonnant à ce que le public français ne connaisse pas cette histoire.
Le grand public oui, mais je suis un peu plus étonné que les professionnels du monde de l’art, conservateurs de musée, critiques d’art, commissaires d’expositions, soient si peu renseignés sur cette question. Le premier moment en France où il y eut un intérêt pour l’art en marge de la voie royale (moderne, américaine, russe, française), ce fut en 1991 avec Les magiciens de la terre. Là il y avait des artistes du monde entier mais pas un artiste noir américain. Et lorsque Catherine Grenier a présenté son accrochage de la collection au Centre Pompidou qu’elle avait intitulé Modernités plurielles, il n’y avait pas non plus un seul artiste noir américain. Tout simplement parce qu’il n’y en a aucun dans les collections du musée d’art moderne.
C’est en effet un contexte édifiant. Pour en revenir à votre exposition, vous revendiquez qu’il s’agit d’une exposition autant historique qu’artistique ?
Oui. Dans l’exposition, il y a précisément 213 œuvres d’art. C’est pour les montrer que l’exposition a été faite. Mais ces œuvres ne pouvaient pas être montrées seules, elles impliquaient un contexte dont il fallait communiquer des éléments au public. Si vous utilisez un mot comme « Reconstruction », terme utilisé par les Américains pour désigner les douze années qui suivent la guerre civile, en France peu de gens le connaissent. Aux Etats-Unis, le terme est aussi connu que « Révolution française » en France.
La qualité esthétique des artistes que vous présentez est exceptionnelle. Il n'y a pas forcément de militance ou de revendication au sein de leurs œuvres.
Il y a toutes les nuances en matière de militance. Prenez un artiste comme Norman Lewis, considéré aujourd’hui comme très important, il est dans la seconde partie de sa carrière un artiste abstrait, sa militance est en filigrane. Une artiste comme Elizabeth Catlett a pris clairement position pendant toute sa vie, elle s’exilera d’ailleurs elle aussi, pas en Europe mais au Mexique. Il n’y a pas un ton commun à tous ces artistes, il n’y a pas une manière unanime de se positionner aussi autour des questions artistiques, politiques et sociales.
Il y a de nombreux débats dans la communauté noire autour de tout ça. Le sociologue et historien W.E.B. Du Bois (1868 - 1963), partisan d’un art très militant, avait écrit un article dans les années 20 qui demandait aux artistes noirs de travailler à la reconstruction de l’image des noirs. Mais un artiste comme Romare Bearden, par exemple, ne voyait pas pourquoi il serait contraint d’entrer sous telle ou telle fourche esthétique. Il n’y a donc pas unanimité mais ces artistes partagent tous quelque chose qui, sous des formes très variées, est représenté directement dans leur art.
Ce qui m’amène à vous demander : existe-t-il une spécificité de l'art contemporain africain-américain ?
Je ne crois pas. L’exposition que je présente pose un problème, à sa façon elle concentre tout l’intérêt sur les noirs eux-mêmes. C’est une étape probablement nécessaire aujourd’hui. Mais dans un monde parfait on ne ferait pas une exposition où n’entreraient que des artistes africains-américains. On ferait une exposition thématique et on mélangerait les artistes concernés, quelle que soit leur origine ethnique ou communautaire. Si c’est le cas ici c’est qu’il faut malheureusement construire une visibilité qui n’existait pas. Ce focus est aussi légitimé par le fait que ces artistes, qui vivent dans une situation où la discrimination continue d’exister, ont en commun l’expérience de la discrimination. Du coup, leur art pointe souvent dans cette direction.
Quand vous regardez Ellen Gallagher, Robert H. Colescott ou Dawoud Bey, pour citer quelques noms d’artistes contemporains dans l’exposition, leur art n’a rien en commun sauf qu’ils ont cette préoccupation liée à la Color line, liée à l’imposition de stéréotypes sur les personnes noires. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a une esthétique africaine-américaine.
Qu’espérez-vous de cette exposition ?
J’espère plusieurs choses. À très court terme, j’espère que la découverte de quelques-uns de ces artistes à Paris va faire que les directeurs de musées, les responsables d’institutions, les commissaires d’expositions vont avoir l’idée de faire quelques expositions monographiques. Je pense que Paris a besoin de recevoir une grande exposition d’Aaron Douglas, ou de Rose Marie Birden. Ce sont des expositions qui ont déjà eu lieu aux Etats-Unis.
Ensuite, à plus long terme, je souhaiterais qu’une exposition ne soit plus du tout nécessaire, dans dix, quinze ans, vingt ans, et qu’on puisse mélanger toutes sortes de choses, qu’on puisse faire des expositions thématiques qui oublieraient la spécificité africaine-américaine. Mais cela voudrait dire que la discrimination se serait considérablement estompée et qu’être un noir aux Etats-Unis aurait cessé d’être un problème. Ce n’est pas pour tout de suite si j’en crois l’actualité.
En quoi le musée du Quai Branly à Paris est-il un lieu approprié pour accueillir cette exposition ?
Ce n’est pas un lieu approprié, c’est un des grands lieux parisiens, un instrument très puissant, avec des moyens qui ont permis de réaliser cette exposition. Cela fait un bon moment que le Quai Branly s’ouvre à d’autres formes d’expression artistique que les arts primitifs ou premiers. L’exposition The Color Line se termine avec le tableau de Mickalene Thomas Origine de l’univers et avec la très belle pièce de David Hammons, sorte de réflexion sur le masque africain. Elle a un côté clin d’œil ici avec les collections du musée. Elle met d’ailleurs en cause la relation de l’Occident à l’art des peuples, nommés primitifs ou premiers, deux termes devenus inféconds, qu’il faudrait apprendre à oublier.
Faut-il distinguer l’art contemporain africain et l’art contemporain africain-américain ?
Je pense que oui. Il y a eu un penseur noir, un philosophe, Alain Locke (1885-2954), qui a été le promoteur de ce qu’on appelle la Harlem Renaissance. Très préoccupé par les arts visuels, il a écrit un article dans les années 20 qui a été objet de discussion, dont l’idée était qu’il fallait que les artistes noirs américains se préoccupent tout particulièrement de ce qu’ils appelaient l’art de leurs ancêtres, à savoir l’art africain. Certains artistes l’ont écouté, d’autres n’ont pas du tout accepté cette manière de voir les choses. En particulier Romary Bearden qui, dès les années 30, a refusé cette injonction et, après la seconde guerre, a écrit un article remarquable dans lequel il écrit : mais qu’est-ce que j’ai d’africain ? Je suis un artiste américain contemporain et je ne peux pas me forcer à réveiller des racines qui sont très lointaines en moi.
Il y a eu le même problème avec le jazz d’ailleurs, il y a eu quelquefois des connexions mais il y a un océan entre le jazz, musique noire américaine, musique urbaine, et les musiques africaines dont le contexte est très différent, dans lequel les traditions des différentes sociétés où ces musiques ont été produites sont restées. Le jazz a évidemment des racines africaines mais il n’est pas pour autant de même nature que les musiques africaines. C’est la même chose pour les arts plastiques. Les artistes africains-américains le revendiquent d’ailleurs, en voulant s’appeler ainsi depuis une trentaine d’années. En même temps, Africain-Américain veut dire people of african descent. Or la descendance n’implique pas l’identité. C’est un débat qui existe depuis longtemps.
L’exposition The Color Line a lieu alors qu’il y a une visibilité nouvelle de l’art africain contemporain et que Paris va accueillir la première foire d’art et de design.
En fait, l’art africain contemporain est bien mieux connu que l’art noir américain contemporain, et depuis plus longtemps. L'exposition Les magiciens de la terre a fait connaître en 1991 une série de noms d’artistes africains, Frédéric Bruly Bouabré, Cherif Samba, et bien d’autres. Depuis cette exposition pionnière, des gens comme André Magnin ont continué à y travailler. Mais aucun artiste noir américain n'était dans l’exposition.
Le paradoxe c’est que les Etats-Unis sont tout près maintenant, pourtant il y a un grand trou noir à l’endroit des artistes africains américains. Ce n’est pas zéro à Paris, il y a eu quelques expositions et quelques artistes sont représentés par des galeries, comme Mickalene Thomas, mais c’est encore peu.
Ellen Gallagher a-t-elle été montrée à Paris ?
Pas à ma connaissance. Elle a été montrée par la Tate Gallery à Londres. Elle vit la moitié de l’année à Rotterdam. Elle est moins connue ici que Carol Kerr ou Carla Simpson, alors qu’elle est plus visible sur la scène mondiale. Elle est allée plusieurs fois à la Biennale de Venise, est représentée par une galerie prestigieuse, Gagossian à Londres. Je pense que c’est un des grands poids lourds de l’art noir américain contemporain. Et j’adore son travail.
Le projet d’une exposition serait mort s’il n’y avait pas de subjectivité dedans. Le travail du curator c’est aussi de faire passer son enthousiasme pour une œuvre. J’ai essayé de montrer des choses auxquelles je tiens beaucoup. Je crois qu’en matière de goût, d’esthétique, il n’y a que le prosélytisme enthousiaste qui a du sens.
Daniel Soutif, philosophe, critique d’art, a été directeur du développement culturel au Centre Pompidou de 1993 à 2001 et à la tête du Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci de Prato (Italie). Il a notamment été le commissaire des expositions Le Temps, vite ! en 2000 au Centre Pompidou ou Le Siècle du jazz au musée du quai Branly en 2009.

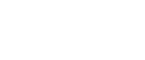 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
