Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Hervé Di Rosa : « Pour comprendre les choses il faut que je m’y colle »
Quand Hervé Di Rosa parle d’art contemporain, son discours est simple, direct, sans prétention. C’est que son art a toujours été à la marge des institutions et des tendances. Prôner ce que Ben a appelé la Figuration Libre alors que l’art conceptuel dominait les expositions, il fallait oser. Ses premières créations véhiculent une culture populaire, aujourd’hui encensée comme la bande dessinée, méprisée par l’histoire de l’art dans les années 80.
Depuis trente ans, ses œuvres parlent d’ailleurs, du Vietnam, du Mexique, de Lisbonne où il vit depuis dix ans, et déportent notre regard d’un entre soi ambiant.
Ce qui caractérise cet artiste c’est son besoin d’expérimenter pour comprendre. Expérimenter la peinture figurative alors que le conceptuel l’entoure, expérimenter la création d’un musée pour mieux exposer des artistes et des œuvres ignorés des grandes institutions, expérimenter des techniques d’artisanat jusqu’à les maîtriser et les adapter à ses créations, expérimenter les chefs d’œuvres classiques pour mieux en comprendre la composition. Une démarche qui n’est pas sans rappeler celle des plus grands créateurs.
Vous avez débuté à une époque dominée par l’art conceptuel, en vous distinguant par une peinture qui empruntait à la bande dessinée, au punk, aux figurines populaires. Ces productions ont été peu montrées par les institutions parisiennes. Qu’est-ce que ça vous inspire ?
À mes débuts, j’avais vingt ans, j’étais exposé à New-York mais pas à Paris. À cette époque, l’art contemporain était très prétentieux et mon art arrivait un peu en réaction. Aujourd’hui encore, la seule institution parisienne qui m’a exposé c’est la Maison Rouge d’Antoine de Galbert en 2016/2017. En région par contre, plusieurs musées ont exposé mon travail, à Valence, Anglet, Roubaix.
Comment s’explique votre attrait pour les objets et productions de la culture populaire ?
Avant de connaître un musée, j’ai lu beaucoup de bandes dessinées, ça a été ma formation avant d’aller aux beaux-arts de Sète, puis à Paris où je suis allé vivre en 1978. Je n’avais eu accès qu’aux images des livres et des magazines, du Journal de Spirou à Métal Hurlant, puis Art Press. J’ai eu du mal à assumer le rapport au musée pendant longtemps. C’est peut-être pour ça que j’ai voulu créer le MIAM à Sète.
Votre processus créatif est très singulier…
Pour comprendre les choses il faut que je m’y colle. Pour comprendre l’art contemporain, j’en ai fait. À 22, 23 ans j’ai serré la main d’Andy Warhol, fait des soirées avec Keith Haring, rencontré Malcom Morley. J’ai appris l’art contemporain en rencontrant les acteurs principaux de cette époque. Mon projet de tour du monde, c’est pour essayer de comprendre comment on fabrique les objets et les images ailleurs dans le monde. J’y vais et j’essaye modestement d’utiliser des techniques spécifiques sur place. Aujourd’hui c’est le même ressort qui me pousse à refaire les trois panneaux de La bataille de San Romano de Paolo Uccello, et des tableaux de Brueghel et d’autres artistes des XVe, XVIe et XVIIe siècles qui m’intéressent. Je le fais pour apprendre la structure de ces tableaux, en les regardant je n’arrivais pas à comprendre. Je suis allé au Vietnam pour apprendre la technique de la laque avec incrustation de nacre. Depuis dix ans que je suis à Lisbonne, j’essaye de percer le secret de la céramique. Tout cela procède de la même démarche.
Vous avez créé le Musée International des Arts Modestes (MIAM) en 2000…
Créer le MIAM, c’était pareil. Quand j’étais plus jeune, dans les année 80, je n’étais pas souvent invité dans des expositions collectives ou personnelles dans les musées. À la fin des années 90, c’était pire, avec un retour de bâton sur les années 80. Donc j’ai eu la chance de pouvoir créer le MIAM pour comprendre comment fonctionnait un musée. Maintenant je sais comment sont répartis les budgets d’une exposition. Comme dans la peinture je m’intéresse à la technique.
24 ans plus tard, le musée est toujours un lieu de résistance esthétique. Pourquoi ?
Avec l’idée des arts modestes, il y avait l’idée d’être en porte à faux, d’être contraire à la grande prétention que je vivais dans l’art contemporain. Pas seulement une prétention d’argent, mais une grande prétention intellectuelle d’avoir un savoir parfait sur la création la plus récente. J’en ai souffert dans mon travail personnel. Ce ne sont pas les néophytes qui viennent au vernissage de mes propres expositions, cela me pousse à expérimenter au MIAM.
Comment concevez-vous votre rapport au public ?
Je vois toujours les expositions comme si mes parents pouvaient les voir. Ils ne comprendraient pas toujours, mais pourraient ressentir, percevoir. Le MIAM essaye d’ouvrir l’art contemporain à la compréhension du néophyte sans tomber dans l’amusement, la mode. Ce n’est pas du ludique que je veux créer, mais un effet. Par des accessoires, des accumulations, en mêlant objets et œuvres d’art, et les images dont les artistes se sont servis, qui les ont influencés. Avec des explications, des cartels, et surtout sur des sujets usuels. Pour donner un autre point de vue que celui des expositions des centres d’art et des musées.
En effet on y trouve autant d’objets de la culture populaire que d’œuvres d’art…
Je les collectionne toujours. Et le MIAM reçoit de plus en plus de dons de collectionneurs. Même si ce sont des objets futiles, quand il y en a 2 ou 3000 cela donne un effet extraordinaire. C’est peut-être que les seuls artistes modestes sont les collectionneurs. C’est d’ailleurs le sujet de l’exposition actuelle. Avec Libres ! je voulais faire entrer des néophytes chez des collectionneurs qui mêlent les objets aux tableaux. Les deux collections sont atypiques, mais à l’intérieur il y a des œuvres historiques. Pour l’un des années 80 de Warhol, de Combas, de Gloach, de moi. Pour l’autre, deux grands peintres français des années 70, Félix Labisse et Lucien Coutaud, injustement oubliés et dont les productions sont en lien avec ce que fait aujourd’hui la nouvelle vague surréaliste aux États-Unis.
24 ans après, le MIAM reste une expérience de laboratoire plutôt qu’un musée définitif. Il y a encore et toujours des sujets éludés, des artistes qu’on ne montre pas. Le MIAM est là pour en parler.
Comment percevez-vous le rapport du public à l’art ?
Je ne sais pas. Les choses ont tellement changé avec Instagram et tous les réseaux sociaux. C’est fascinant, on est en contact avec plein d’images d’artistes formidables.
J’ai le sentiment que mon projet tour du monde n’a plus la même fonction aujourd’hui. Les projets au Cameroun avec les fondeurs de bronze et les tailleurs de bois je ne pourrai plus les faire. Au Vietnam non plus, l’atelier de nacre du maître laqueur Le Nghieêm a disparu. Ce que j’ai fait dans les années 90 jusqu’en 2010 c’est devenu de l’histoire dans ces pays. En Afrique subsaharienne, à l’époque, on connaissait quelques artistes grâce à l’exposition Magiciens de la terre, mais très peu utilisaient les techniques de là-bas. Vingt ans après, les jeunes artistes africains utilisent tout ça. Ça m’intéresse moins et eux ont moins besoin de reconnaissance, beaucoup sont dans le circuit. Là ou ailleurs, j’ai essayé de démontrer, de donner à voir les possibilités de ces techniques artisanales qui étaient considérées lointaines, pas intéressantes. Le MIAM en 2000 a été la première association et lieu public à accorder une exposition à deux artistes africains, l’un de Kinshasa, l’autre du Bénin. Leurs sculptures, une commande, sont toujours dans la cour du MIAM.
Vous allez continuer à voyager…
Bien sûr. J’habite à Lisbonne, et j’envisage d’aller au Brésil. J’ai toujours fait le projet tour du monde en parallèle à mon projet d’atelier normal où, ces dernières années, je travaille à la relecture de toiles anciennes, ainsi qu’à mes installations et aux collections de figures, articulées ou non, traditionnelles ou en plastique. D’ailleurs au Centre Pompidou, il y aura une grande vitrine où sera installée une petite partie de ma collection de figures et figurines. Ce sera la présence du MIAM dans l’exposition Passe-Mondes. Et le public verra mes influences, ce qui facilite la lecture de mon travail.
Aujourd’hui qu’est-ce qui vous influence ?
Tous les jours un truc différent me passionne. Je travaille sur un projet au Mucem. J’ai choisi une vingtaine d’objets de la collection de l’ancien musée des arts et traditions populaires, des grands buffets normands, un luminaire 1800, un joug de bœuf, et je vais les enchâsser dans mes peintures. C’est une proposition du nouveau président du Mucem. Quand j’ai visité les réserves, j’ai vu des objets incroyables de la vie quotidienne, des cuillères en bois à des personnages en plastique et des grosses têtes de carnaval en papier mâché. Tous répertoriés, étiquetés. J’ai choisi les objets les plus difficiles pour moi, un peu arides, que j’essaye de mettre en scène pour en faire une histoire.

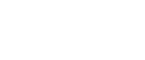 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
