Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Avignon : Ostermeier montre le radicalisme
Plateau tournant, mobilier modeste des années 70 et pagaille assumée jusque dans les moindres détails, la scénographie est classique mais elle convient à merveille à l’adaptation du Canard sauvage conçue par Thomas Ostermeier pour le Festival d’Avignon. Le directeur de la Schaubühne de Berlin a resserré le texte autour des famillles Ekdal et Werle, le situant de nos jours et éliminant toutes les annexes et digressions dont Ibsen aime à doter ses pièces. L’intrigue est simple : les deux grands-pères ont été jadis liés par des affaires qui ont mal tourné pour l’un, l’ex-lieutenant Ekdal, et réussi pour l’autre, Werle. Le premier a été condamné, le second acquitté. La génération suivante est également en lien, Hjalmar Ekdal, humilié par la ruine de son père, est ami avec Gregers Werle qui ne supporte pas la malhonnêteté de son géniteur. La troisième génération, représentée par la jeune Hedwig Ekdal, va subir les conséquences de cette histoire qui se passe dans une petite ville de Norvège où le luthéranisme est de rigueur.
De l’importance d’un canard. Hedwig, qu’Ostermeier veillit de quatre ans en lui donnant dix-huit ans, ignore nombre de choses qu’elle va découvrir : la concupiscence de Werle, le puritanisme de Gregers, l’idéalisme futile de son père et le silence de victime de sa mère Gina. Pragmatique face à un père incapable d’assumer le quotidien et à une mère soumise, elle est la seule à ne pas être mêlée à ces histoires familiales. Du moins le croit-elle, car elle est en fait au cœur du problème sans avoir rien demandé. Certains traducteurs nomment d’ailleurs la pièce La Cane sauvage en raison de la terminaison féminine qui est employée en plusieurs occurrences dans la pièce, alors que le titre possède en norvégien la terminaison neutre. Ibsen écrit explicitement le lien entre Hedwig et la cane à trois reprises. C’est que la cane a son importance. Manquée au cours d’une partie de chasse par le vieux Werle, elle est recueillie par le vieux Ekdal qui la soigne dans son grenier.
La « Vérité », un radicalisme destructeur. Victime comme sa mère, mais d’une autre façon, Hedwig va assister à la décomposition furieuse de ce monde, sous les coups de butoir du forcené Gregers Werle. Celui-ci ne pardonne pas à son père les écarts qui ont conduit à l’alcoolisme puis à la mort de sa mère. Il va découvrir qu’il ne s'est pas mieux comporté avec la famille Ekdal et que son père ne l’a rappelé auprès de lui que pour lui faire accepter son mariage avec la gouvernante qui rassure ses vieux jours menacés par la maladie. Comme un puritain prêt à tout ravager pour faire triompher sa religion, il ne croit qu’en la « Vérité » comme idéal de rédemption et de libération. Ce n’est pas tout à fait ce qui va se passer. Cette « Vérité » radicale qu’il tient absolument à prodiguer, convaincu que sa morale sauvera l’humanité et que sa position, étant la bonne, ne peut souffrir ni nuances ni exception, va entrainer des conséquences désastreuses. Ostermeier, qui aime bien introduire des parenthèses où le public est consulté sur un thème, a choisi ce radicalisme pour faire interagir des spectateurs plus amusés qu’irrités par le prosélytisme de Gregers.
Des hommes inutiles, des femmes agissantes. Intelligemment interprété par Stefan Stern, Hjalmar Ekdal est un summum d’inefficacité et de vantardise. On découvre vite que son métier est en fait exercé par sa femme qui, avec sa fille, assure en outre tout le fonctionnement de la maison. Pour la moindre chose, une bière, aller chercher sa guitare, ce sont elles qui sont à la manœuvre alors que le père ne sait que discourir sur les responsabilités qui l’accablent, « s’éreinter » sur un travail qu’il ne finit jamais et se bercer d’illusions sur la grande invention qui, un jour, lui rendra l’honneur perdu de sa famille. Au moindre conflit, il déserte, laissant les femmes assumer. Par sa vanité, il poussera jusqu’à la tragédie, incapable de mesurer ses paroles, de prendre ses responsabilités, de recadrer le « justicier » Gregers qui s’est octroyé les rennes de son destin et le conduit au drame.
Des dangers du radicalisme. Tous les hommes de la pièce sont ainsi non seulement veules, égoïstes et incompétents mais ils sèment le malheur et la mort. Les femmes, à l’inverse, agissent. Berta Sorby, la gouvernante, impose sa reconnaissance par le mariage et la direction d’une main de fer de la maison Werle. Gina Ekdal, victime qui n’a pas eu justice, parvient néanmoins à faire vivre la famille. Quant à Hedvig, elle est la seule à appeler les choses par leur nom, à agir à la maison comme dans le journal qu’elle a lancé. Devenue journaliste par la grâce d’Ostermeier, elle présente l’autre version de la vérité chère à Gregers : les faits afin que chacun puisse se faire un jugement et non un jugement unique qui serait inhérent aux faits, ce qui est le propre d’un régime autoritaire. Sans trancher, comme son maître Ibsen qu’il met régulièrement en scène depuis quinze ans, Thomas Ostermeier laisse le public en questionnement sur cet usage radical de la vérité qui mène au pire des drames, celui qu’aucun des personnages n’a voulu et qui les marquera à vie.
Le Canard Sauvage d’après Henrik Ibsen. Mise en scène Thomas Ostermeier. Création Festival d’Avignon 2025. À l'opéra du 5 au 16 juillet. Avec Thomas Bading, Marie Burchard,Stephanie Eidt, Marcel Kohler, Magdalena Lermer, Falk Rockstroh, David Ruland, Stefan Stern. Reprise à la Schaubühne de Berlin du 12 au 21 septembre et à l’Argentina de Rome les 23 et 24 janvier 2026.

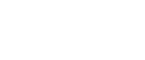 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
