Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Du cultuel au culturel
On l’ignore souvent : l’église catholique est une puissance économique qui se matérialise dans les biens fonciers et immobiliers. Avant la Révolution de 1789, elle était de loin la première propriétaire en France, possédant par exemple les deux tiers du parc foncier parisien. Après le dépouillement opéré à la fin du XVIIIe siècle, la Restauration n’a pas rendu tous ses biens à l’église et la loi de séparation de l’église et de l’État, dont on fête le 120e anniversaire a cédé à la nation et aux collectivités un grand nombre de bâtiments que l’église ne parvenait plus à gérer.
La désaffection des fidèles pour les pratiques religieuses se confirmant de décennies en décennies, nombre d’églises et de chapelles ont été désacralisées, et des lieux monastiques prestigieux appartenant à des congrégations sont passés dans le domaine public. La loi de 1905 autorise en effet une désacralisation en cas de non-célébration du culte ou insuffisance d’entretien. Rénovés, adaptés ou repensés par des cabinets d’architecte, plusieurs d’entre eux ont été transformés en centres d’art contemporain, lieux d’exposition, scènes d’art vivant.
Abbayes et monastères. L’Abbaye royale de Fontevraud, près de Saumur, est le plus grand site monastique d’Europe. Prison jusqu’au XIXe siècle, le vaste ensemble est aujourd’hui géré par le Centre culturel de l’Ouest (CCO) créé par la Région Pays-de-la-Loire en 1975. Hébergeant un musée d’art moderne qui possède des œuvres de Toulouse-Lautrec à Germaine Richier en passant par Degas, Van Dongen, Derain… l’abbaye est également lieu de concerts et de résidence pour artistes.
Comme, à 30 kilomètres au nord de Paris, l’Abbaye de Royaumont, haut-lieu culturel depuis les années 1930. À cette époque, sous l’impulsion du Front populaire, Henry et Isabel Gouïn, riches propriétaires de l’ancien monastère cistercien jadis occupé par l’industrie textile, décident d’en faire un lieu nouveau. Ancêtre des futures résidences d’artistes, l’abbaye va accueillir le Foyer de Royaumont, lieu de travail et de repos pour artistes et intellectuels. Mais peu à peu, la fondation manque de budget et le département du Val-d’oise va prendre le relai, axant le travail sur la musique, la chorégraphie et la poésie. Y séjourneront notamment l’ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon et la chorégraphe américaine Susan Buirge qui a beaucoup œuvré à l’introduction de la danse contemporaine en France. En plus des résidences, des concerts sont programmés tous les dimanches.
Le monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse, est devenu civil en 1906 suite à la loi de laïcité et transformé immédiatement en lieu culturel. Musée municipal depuis 1922, réaménagé entre 2018 et 2022, le monastère propose également des expositions temporaires et une programmation d’arts vivants. Jusqu’au 8 mars 2026, on peut y voir une exposition d’art contemporain Incarnations, corps à corps réalisés à partir des collections du macLyon. Le corps est largement représenté et mis en scène dans l’art « mais aussi utilisé comme outil ou support de créations, il est au cœur de l’acte créatif » explique les organisateurs.
Les bâtiments des Ursulines. Fondée par l’italienne Angèle Merici, née en 1474, l’ordre des Ursulines avait pour vocation l’éducation des jeunes filles, ce qui en fit un des mieux doté en bâtiments dont un grand nombre ont été rendus à la vie civile et transformés en lieu culturel. À la fois Scène nationale et Centre d’art contemporain d’intérêt national, le Carré de Château-Gonthier, en Mayenne, peut s’enorgueillir de posséder deux labels nationaux prestigieux de la culture. Grâce à son théâtre construit en 1999 dans le couvent des Ursulines et ses espaces d’exposition de la chapelle du Genêteil datant du XIIe siècle. Cette dernière ne rouvrira qu’en 2026, le temps d’une nouvelle réhabilitation pour le centre d’art accueilli provisoirement dans les bâtiments voisins du « 4 bis ».
Sous l’impulsion de son directeur Maël Grenier, le Carré organise depuis cinq ans des rendez-vous réguliers en plus de la programmation saisonnière. Après le festival Aire de jeunesse(s) qui se tient durant les vacances d’automne, Gontierama est un parcours d’art contemporain à travers la ville de Château-Gonthier. L’édition 2026, du 30 mai au 23 août, accueille six artistes dont François Dufeil, Harals Fernagu, Makiko Furuichi, Stefan Rinck. Enfin Au temps pour nous ! offre dix jours de réflexion sur des thématiques liées à la citoyenneté et à l’écologie.
Dans le Gard, c’est la chapelle des Ursulines de Sommières qui abrite aujourd’hui l’Espace Lawrence Durrell, du nom de l’écrivain britannique qui a séjournée dans la ville avec un espace d’exposition de 107 m2 et une médiathèque. À Montpezat-de-Quercy, une médiathèque et une école de musique occupent le couvent. À Macon, c’est un musée municipal ouvert en 1968. À Clermont-Ferrand, les bâtiments de la congrégation sont devenus le musée des beaux-arts qui renferment plus de deux mille œuvres d’arts plastiques et décoratifs.
L’ensemble le plus notable est sans doute à Montpellier. Le couvent des Ursulines, situé dans le centre historique, est aujourd’hui Agora, la Cité internationale de la danse. Acheté par la ville en 1980, Agora dispose d’un atelier de construction, des hébergements pour les artistes, des salles de répétition, d’une salle de spectacle doublée l’été d’une salle en plein air. À la direction de son Centre chorégraphique national (CCN) on a pu voir des chorégraphes prestigieux comme Dominique Bagouet ou Mathilde Monnier. La Cité internationale accueille toute l’année des compagnies, des artistes et offre une riche programmation. Cette ancienne prison pour femmes, puis de la Gestapo, est également le siège du festival international Montpellier Danse, le plus important festival de danse contemporaine en France.
Avignon, cité papale. Accueillant le plus grand festival d’arts vivants d’Europe, l’ancienne cité papale, outre son palais, abonde en églises, cloîtres, chapelles et autres lieux de culte où se déroulent spectacles et expositions. Plusieurs d’entre eux ont été désacralisés et accueillent aujourd’hui les spectacles du festival, comme l’église des Célestins, le cloître des Carmes et la chapelle des Pénitents blancs. Le musée lapidaire de la ville est installé dans l’ancienne chapelle du Collège des Jésuites. Plus des deux tiers des édifices religieux du centre historique font place à des spectacles, mais tous ne sont pas désacralisés.
Le cas des bâtiments de l’ordre des Antonins, qui fut l’un des plus fastueux d’Avignon, est singulier. C’est en effet la Révolution française qui désacralisa les lieux. Sa chapelle devient centre culturel américain en 1970. Après sa rénovation par des particuliers, elle accueille aujourd’hui le théâtre La Factory.
Et ça continue. Inauguré le 3 juillet dernier, le centre culturel Simone Veil de Sarcelles en sait quelque chose. En 2015, l’Ehpad du Cèdre bleu quitte l’ancien dispensaire de l’ordre du Saint-Sacrement et sa chapelle qui intéresse la ville. Elle va confier à l’architecte Patrick Mauger sa transformation en auditorium alors que les autres bâtiments sont destinés au conservatoire, à des ateliers d’art et à une médiathèque. Un pavillon adjacent accueille l’atelier théâtre et des résidences d’artistes. Le budget global dépasse les 11 millions d’euros. La Maison des arts, de la culture et des associations programme des concerts et, à cheval sur novembre et décembre, la Biennale internationale de la gravure.
Le mois précédent, c’est Saint-Anne à Montpellier, principale église néo-gothique dans le centre historique, qui a rouvert ses portes. Désacralisée à la fin des années 80, accueillant des manifestations culturelles diverses, dont de très belles expositions comme celles de Gérard Garouste, Hervé Di Rosa ou Chiharu Shiota, elle a dû fermer en 2017 en raison de la fragilité du bâtiment. Grâce à 4,7 millions d’euros d’investissement intégralement assumés par la ville, le Carré Sainte-Anne a offert son immense nef de 600m2 en juin dernier pour une exposition monumentale Adventice (jusqu’au 4 janvier) de l’artiste JR. La capitale languedocienne a également investi la grande chapelle de l’ancien hôpital Saint-Charles. Convertie en Maison des chœurs, elle accueille des répétitions de l’orchestre national de Montpellier et des concerts. Et inauguré en avril dernier un nouveau centre culturel, la chapelle de Nazareth.
Des dizaines d’autres lieux anciennement cultuels offrent aujourd’hui en France des activités artistiques variés. À Bordeaux, l’Utopia, seul cinéma art et essai du centre-ville, occupe de ses cinq salles les bâtiments de l’ancienne église Saint-Siméon depuis 1999. La Chapelle de Clairefontaine, dans la commune éponyme en Yvelines, fête ses dix ans en organisant une exposition Témoigner, créer au mois de novembre. Le Carré Saint-Cyr à Vaudreuil, en Normandie, est dédié à l’artisanat d’art. Trois églises désacralisées de Toulouse sont lieux de concerts, d’expositions et de soirées électro.

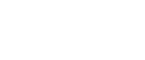 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
