Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Ludivine Sagnier, « la passion dans le théâtre »
Le roman "Le consentement" livre une parole peu entendue et une situation complexe. Comment l’interprétez-vous ?
J’ai été sensibilisée aux abus sexuels sur mineur dans mon entourage très proche. J’ai dû faire face à des situations cataclysmiques ces dix dernières années. Des situations plus complexes que ce qu’on projette sur ces histoires. C’est un sujet qui me travaillait. Me sentant impuissante à reconstruire ces personnes, je me suis dit que c’était une manière de mettre ma pierre à l’édifice de cette résilience, de cet apaisement. C’est pour ces proches que je sentais la nécessité de m’impliquer. Et puis il y avait le challenge d’être seule en scène, on ne m’avait jamais proposé ce défi. J’arrive à un moment de ma vie où je me sens beaucoup plus libre et plus en accord avec moi-même, je me sens la force d’embrasser des défis, de réussir l’impossible. Au début des lectures en répétition, je ne faisais que pleurer, j’étais dans un rapport compassionnel, empathique avec ces mots et avec Vanessa. Or l’enjeu de Sébastien Davis, le metteur en scène à l'origine du projet, et le mien, c’était d’arriver à trouver cette distanciation parce que c’est ce qu’a fait Vanessa Springora. Elle n’écrit pas son livre à 17 ans, elle l’écrit trente ans après. Elle a eu le temps de se poser les bonnes questions, d’analyser la situation, de guérir surtout. Les mots qu’elle choisit ne sont pas empreints de colère, ou de traumatisme. Ce sont des mots assez simples, nullement mélodramatiques. Il fallait surtout que j’évite le côté mélodramatique, ça n’aurait pas été faire honneur à un combat de sa vie et à sa littérature. À la sortie du roman on a beaucoup parlé de « l’affaire Matzneff » mais on n’a pas parlé de l’auteure Vanessa Springora. Or c’est une œuvre qui dépasse de loin le simple fait divers, le témoignage, elle a sublimé cette expérience traumatique pour en faire un vrai objet artistique.
Et cela rend le texte audible…
Oui. Il ne s’agit pas que les spectateurs viennent se repaître d’un fait divers, il s’agit plutôt de les interroger même sur leur désir de voir cette histoire montée à la scène. N’y a-t-il pas un intérêt malsain ? Y a-t-il vraiment une remise en question de celui qui regarde ? L’objectif est de questionner le spectateur sur sa façon de voir les choses, son rapport au consentement et à la passivité. À un moment Vanessa parle du manque d’amour : « un père aux abonnés absents, un goût prononcé pour la lecture, une précocité sexuelle et un immense besoin d’être regardée, toutes les conditions sont maintenant réunies ». Dans les conditions, souvent communes aux enfants ou adolescents victimes de prédateurs, il y a ce manque d’amour, il y a ce manque d’intérêt, un trouble identitaire.
Quel est votre rapport au théâtre ?
J’aime beaucoup le théâtre. J’en ait fait longtemps dans mon enfance, j'ai fait le conservatoire de Versailles quand j’étais adolescente. C’est d’ailleurs Sébastien Davis, qui met en scène la pièce, qui m’avait donné la réplique, il jouait Arnolphe et je jouais Agnès dans L’école des femmes. J’ai toujours été une spectatrice de théâtre assidue. Adolescente j’ambitionnais d’en faire plus mais le cinéma m’a happée. J’ai rencontré Ozon à 19 ans, ensuite les choses se sont enchainées. On m’a proposé beaucoup de théâtre mais c’était des formes classiques, un théâtre psychologique, plutôt bourgeois, j’aime bien mais je ne me voyais pas m’y investir corps et âme. Si je fais du théâtre c’est 100% ou rien. Je cherchais la passion dans le théâtre.
Parlez-nous de l’école de cinéma Kourtrajmé...
J’ai fait appel à Sébastien Davis, mon complice de toujours, pour créer la section acteur de l’école de cinéma Kourtrajmé que Ladj Ly a fondée il y a trois ans. Je cherchais quelqu’un avec qui je me sentais suffisamment confiance, pour qui j’ai suffisamment d’admiration et avec lequel je partageais des valeurs. Sébastien a été acteur, il a étudié la mise en scène à l’ENSAD, fait de nombreuses formations, il a des connaissances théoriques qui servent sa pédagogie. Ce que je n’ai pas. Ayant commencé le cinéma très tôt, les outils que j’ai développés sont souvent instinctifs, je ne peux pas les transmettre aisément.
Nous avons conçu ensemble la section en créant la formation qu’on aurait rêvé de suivre. Pour nous c’est une œuvre de créer, d’une part un enseignement, et d’autre part d’avoir cette matière vivante que sont les acteurs et de les faire accoucher d’eux-mêmes. Le pré-requis de cette école, qui est gratuite, c’est de n’avoir aucune formation d’art dramatique. Donc c’est un matériau brut qu’on développe, qu’on stimule et on apprend surtout une autonomie artistique, à ne pas dépendre du désir des autres, à être créatif. Les élèves ont des projets personnels à présenter où ils sont eux-mêmes auteurs, metteurs en scène, etc. C’est passionnant. Sébastien leur enseigne une pratique et moi, en l’écoutant, j’interviens en décrivant ce qui m’est arrivé sur le plateau, mes propres anecdotes. Je pense que c’est bien d’avoir une directrice qui travaille, qui est en mouvement, qui n’est pas dans le souvenir d’une carrière. Je peux raconter qu’hier j’étais sur le tournage, il y avait ceci, il y avait cela. J’ai l’impression d’apporter une réflexion mouvante, mobile. Du coup notre binôme fonctionne très bien.
Vous avez eu tous les deux le même enseignement, l’école de théâtre pour enfant de Sèvres, puis le conservatoire de Versailles, avez-vous été critiques de cet enseignement pour inventer celui de Montfermeil ?
C’est vrai que ce n’est pas le même public. Quoique l’an dernier est venue une jeune Versaillaise et nous étions très fiers de l’accueillir parce que c’est aussi ça la diversité. Elle doit être totale, pas dans un seul sens. Au conservatoire on travaillait des scènes classiques, modernes. On partait toujours du texte, c’est un standard dans la pédagogie dramatique française. Or quand on voit d’autres formes d’expressions théâtrales, que ce soit dans le théâtre indien, japonais ou même américain, ce n’est pas du tout le même postulat de départ. Donc, parce qu’on s’adresse à des gens qui ont des origines très diverses, on essaye de s’éloigner du patrimoine culturel français qui souvent est un objet de complexe culturel pour des gens issus de l’immigration, peu initiés par leurs parents, culpabilisés par leurs profs de français, jamais valorisés dans leur richesse, alors qu’ils sont tous bilingues. Pour nous, l’idée de partir du corps, de l’instinct, permet une égalité bien plus objective. Ils ont des cours de clown, de krump, de percussion corporelle, de chants du monde, de polyphonie. Il n’y a pas besoin d’avoir lu les classiques. Par contre il y a un module sur la tragédie où on aborde Andromaque. Là il y a un travail d’explication de texte, mais ce n’est pas très compliqué. Je leur fais des fiches de vocabulaire : le courroux, les feux, les vaisseaux, l’hymen, etc. Vingt mots posent problème, ça prend vingt minutes pour dédramatiser. Il faut juste en avoir l’envie.
J’ai l’impression d’être assez mobile dans les classes sociales, je me sens très bien avec des jeunes au quartier, je comprends leurs préoccupations, et je me sens très bien avec des patrons. C’est un des objectifs de ma vie en tant que femme. On parle de mixité sociale mais il faut soi-même savoir être mixte.
Bio
Ludivine Sagnier rentre en 1994 au Conservatoire d'art dramatique de Versailles, où elle remporte les premiers prix au concours classique et au concours moderne. Elle débute au cinéma en 1988 dans Les Maris, les femmes, les amants ainsi que dans des courts métrages, dont Acide animé qui lui permet d'obtenir le Lutin de la Meilleure comédienne en 1999.
Le grand écran va la happer avec sa rencontre avec François Ozon pour Gouttes d'eau sur pierres brûlantes (2000), puis 8 femmes (2002) et Swimming pool (2003). Elle tournera avec Claude Miller, Claude Chabrol, Alain Corneau, Christophe Honoré... avant d'intégrer des castings internationaux en incarnant la fée Clochette de Peter Pan sous la direction de P.J. Hogan ou cette année dans The Serpent Queen. Elle avait déjà tourné dans Lupin et The New Pope de Paolo Sorrentino.

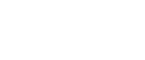 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
