Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Naïma Yahi : « nous partageons un héritage riche et intéressant ».
L’exposition Générations, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France a été présentée à Lyon cet été, pouvez-vous nous dire votre intention de la présenter à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration ?
Cette exposition est conçue par l’association Génériques qui a soutenu le montage de la première exposition sur la mémoire collective France des étrangers, France des libertés. L’association, créée fin 87, a pour vocation la préservation et la valorisation des archives publiques et privées qui ont trait à l’histoire des étrangers en France. Et de rendre accessibles ces documents inventoriés depuis vingt ans. Cette exposition ne pouvait se réaliser ailleurs que dans un lieu que l’association a voulu depuis de nombreuses années et pour lequel elle s’est impliquée : la Cité Nationale de l’Histoire de l'Immigration (CNHI). Destinée à être itinérante, l’exposition a d’abord été présentée cet été à Lyon.
Les données historiques de la période abordée au Maghreb, de la seconde moitié du XIXe à aujourd’hui, sont méconnues en France et suscitent peu d’intérêt, comment s’articule le fil historique de l’exposition ?
Le fil conducteur, c’est la musique. La CNHI a développé des outils pédagogiques adaptés aux enfants comme le parcours d’une heure guidé par un questionnaire, des moments réservés à la lecture d’œuvres littéraires. La programmation autour de l’exposition est ambitieuse. Concerts, lectures, mise à disposition de conférenciers pour une visite. L’exposition est esthétiquement attrayante. Conçue comme un outil pédagogique, elle recourt largement au multimédia. Un parcours de couleurs matérialise chaque tranche chronologique pour faciliter la transmission au public qui a besoin d’être conduit dans l’histoire qui lui est racontée.
L’art, la musique en particulier, n’occupe pas seulement l’espace sonore. Quelle est sa place dans l’exposition ?
Nous avons édité un coffret de musiques dans les trois langues, reprenant les grands tubes des années 30 aux années 70. La musique est une culture populaire, elle peut donner voix au chapitre de son histoire, les artistes y transcrivent les angoisses du peuple, dans les langues d’origine donc incompréhensibles. Certaines chansons ont été traduites, avec elles on peut glaner des sensations, l’émergence d’une culture. La pertinence de cette production musicale apporte des indices liés aux modes de vie des populations en France à cette époque. La communauté maghrébine s’était regroupée et une connivence était née entre les populations de confessions juive et musulmane. Les artistes produisaient les mêmes musiques, chantaient les mêmes choses. Avant les années 70, c’était la même famille musicale et il y avait une dizaine de cabarets orientaux dans le quartier latin où se produisaient des artistes des deux confessions. Puis il y eut la rupture politique de 70 et les cabarets n’ont plus fonctionné. Les tensions qui existent, jusqu’à aujourd’hui, nous font oublier tout cela. L’enjeu de l’exposition est de les porter à la connaissance de nos contemporains.
L’actualité politique porte sur l’identité nationale avec le débat lancé par le ministre Eric Besson. Comment situer l’histoire de l’immigration maghrébine contemporaine dans ce contexte ?
L’identité nationale est par essence en évolution. Elle sera ce que sera son enrichissement, son héritage culturel. Plutôt que d’être dans l’exclusion, ce que l’exposition décrit c’est que dans nos cultures, nous partageons un héritage riche et intéressant. Qui ne se limite pas à la cuisine mais englobe la pratique syndicaliste, la presse de l’entre-deux guerres, des personnages comme Messali, Ben Ghabrit ou encore Edmond-Nathan Yafil... C’est vrai aussi pour les autres populations étrangères. La résonance de l’exposition n’est pas le fruit du hasard. Actuellement, il y a une demande sociale et une légitimité sociale très forte des maghrébins. D’où l’importance de l’héritage de ces populations.
Comment régissez-vous au référendum suisse du 29 novembre duquel résulte un non à la construction des minarets ?
Il est compliqué de réagir par rapport à la Suisse. Son système démocratique est tel qu’on demande à la population tout et son contraire. Et sa culture est très différente de la nôtre. En France, on peut revendiquer sa part de spécificité. La question de l’Islam se pose aujourd’hui en France, alors que celle-ci s’affirmait première nation musulmane de l’entre-deux guerres pour des raisons hégémoniques.
Âgée de 32 ans, Naima Yahi est docteur en histoire culturelle, chargée de recherche pour l’association Génériques. L’action de cette association s’est concrétisée par la publication de l’ouvrage Les Étrangers en France – Guide des sources d’archives publiques et privées – XIXe- XXe siècles. Cet ouvrage numérisé est accessible sur le catalogue des ressources en ligne Odysséo, sous forme d'une base de données permettant une recherche multicritères.

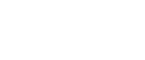 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
