Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Olivier Mantei : « L’opéra du XXIe siècle est celui qui rassemble »
L’histoire de l’Opéra-Comique est prodigieuse…
La particularité de cette institution, c’est qu’elle s’est créée par son répertoire. Et elle en porte le nom. Comique est à prendre dans le sens comédie dramatique. Les grandes œuvres du répertoire ne sont pas forcément drôles, à l’instar de Carmen, Manon, etc. C'est un théâtre musical, ce sont les chanteurs qui parlent. Cela pose plusieurs questions : un lieu assez intime pour des raisons acoustiques, la voix parlée porte autant que la voix chantée, c’est le cas de la salle Favart et ses 1200 places toutes très proches de la scène. Et un travail avec les chanteurs qui repose autant, voire plus, sur le jeu théâtral que sur la projection vocale. Il y a donc un souci de clarté, de compréhension.
Qu’est ce qui fait que l’Opéra Comique s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui ?
Tournant le dos au boulevard des Italiens, un peu replié sur lui-même malgré ses 300 ans d’histoire, l’Opéra Comique est le théâtre où l’opéra le plus populaire a été créé, Carmen. C’est toute l’ambivalence de cette maison, à la fois petite et toujours en résistance. Pendant trois cents ans contre l’envahisseur, contre une volonté d’en faire autre chose, ou en manque de moyens. Elle a plusieurs fois failli disparaître. En même temps, les œuvres y étaient jouées plus de 1500 fois. C’était un vrai opéra populaire. Carmen n’a pas marché tout de suite mais bien après. Le Domino noir, actuellement représenté, est une œuvre qui a été jouée 1200 fois. C’étaient de vrais succès.
Ces succès sont lointains…
L’Opéra Comique a pali un peu au moment de la création dans la 3eme Salle Favart (restaurée après deux incendies) de Pelléas et Mélisande. Debussy et Maeterlinck apportent une prosodie d’une clarté et d’une transparence telles que le parler chanter prend un coup de vieux. Je pense que la bascule a lieu là. Ensuite tout le XXe siècle voit le genre de l’Opéra Comique un peu poussiéreux.
Aujourd’hui il refait surface, de manière forte et pas seulement ici. Il y a une génération d’artistes, de metteurs en scène, de musiciens pluridisciplinaires, qui ont appris autant le théâtre, la musique que la danse, et sont très ouverts sur un univers polymorphe. L’Opéra Comique, avec son répertoire, devient une opportunité pour eux de faire du théâtre musical, ce qu’ils recherchent.
Vous êtes à la tête de l’institution, comment voyez-vous l’avenir du genre ?
J'ai étudié les lettres, puis la musicologie. J’ai une double origine, théâtre et musique. Et une même sensibilité aux deux. Le pari de l’opéra du XXIe siècle c’est justement ne pas en faire qu’une discipline de chef ou de metteur en scène mais d’en faire vraiment du théâtre musical. Au sens où on donne du temps au théâtre, aux répétitions. C’est aussi important que la musique ou la qualité des voix. En faire un art total, une chose pas si évidente. L’économie de l’opéra encourage peu. Cela coûte cher, il y a beaucoup de monde. Plus que pour une pièce de théâtre.
Quand, avec Olivier Poubelle, nous sommes arrivés en 2010 à la direction des Bouffes du Nord, arès avoir travaillé avec Peter Brook, nous nous sommes demandé : est-ce qu’on prend le théâtre tel qu’il est aujourd’hui et on l’entretient comme un musée légendaire ? Ou nous remettons-nous dans la situation où Peter Brook a découvert les Bouffes en 1974 ? Nous nous sommes dits, c’est ce qu’il faut faire, l’héritage est là, si on ose parler d’héritage.
Quand j’ai pris la direction de l’Opéra Comique, je me suis posé la même question. Avec Jérôme Deschamps, nous avons réinstallé pendant huit ans le répertoire, l’identité. Cela redevenait une maison lyrique à part entière. Avec une famille d’artistes totalement engagés derrière le projet. On pouvait continuer, mais je me suis demandé s’il ne fallait pas se lancer de nouveaux défis. Notre mission n’est pas de s’installer dans quelque chose, l’Opéra Comique est un établissement public de création. Une maison d’opéra qui ne crée pas devient un musée. Or un musée n’est intéressant que si on lui ouvre les portes de son époque. Il fallait que la création interroge le genre aussi : c’est quoi l’Opéra Comique au XXIe ? Plus de créations, toucher un nouveau public, ouvrir avec le numérique. Rendre le lieu moins confidentiel, c’est-à-dire jouer plus.
Le renouvellement de la création joue d’ailleurs sur le renouvellement des publics. Renouveler le public, ce n’est pas seulement faire de la médiation et des tarifs intéressants. Il faut une programmation qui va interroger une autre génération. Certains de nos projets sont vraiment générationnels, il y a eu une vraie facture.
Quels sont les effets ?
Nous avons doublé les effectifs de la jeunesse. Sur l’opéra, nous avons une progression des 18-35 ans de 153%. Il faut plus raisonner en culture pour chacun qu’en culture pour tous. Alterner des productions du répertoire et une part importante à la création. C’est une petite maison. Nous avons moins de 20 millions de budget. À titre de comparaison, l’Opéra de Paris c’est 220 millions. Nous sommes dans une économie de gros théâtre.
Nous avons 35% de lever de rideau en plus, une augmentation de 30% du public en 2017. Nous avons multiplié par trois les tournées internationales. Nous avons de plus en plus de coproductions, qui font tourner les spectacles. En 2017, nous sommes passés d’environ 50 000 places payées à 65000, avec la même marge artistique. C’est une belle progression mais, au-delà de ça, nous sommes toujours en asphyxie budgétaire. Il faut trouver le bon mode de fonctionnement pour pouvoir supporter cette augmentation.
Pourtant vous programmez de nombreuses créations…
Nous venons de faire un festival jeune public composé uniquement de créations. Si on se pose la question de toucher un jeune public forcément on va vers la création. Cela pose la question de la durée de spectacle, de contenu, de forme.
Nous avons aussi interrogé le répertoire baroque avec Et in Arcadia Ego, une création aux effets étonnants. Nous interrogeons aussi la musique contemporaine : Kein Licht est une vraie production internationale, primée d’ailleurs, qui interroge la forme opéra-comique. C’est un travail commun entre le texte, la mise en scène, la composition. Le temps de l’écriture musicale coïncide avec le temps de la mise en scène, ce qui est assez rare. Quand Peter Brook a travaillé sur La flûte enchantée, ou quand il a lancé Carmen, il avait l’idée d’en finir avec le double point de vue.
La création aujourd’hui peut offrir cela. On n’est pas forcément dans la réécriture d’une histoire, d’une œuvre, ou dans une transposition. Cela m’a conduit à mettre en place un travail d’un an avec Joël Pommerat et Francesco Filidei. Le livret s’écrit en même temps que la musique et en même temps que la mise en scène. Donc toutes les intentions, musicales, littéraires, scéniques, ou même scénographiques, sont pensées simultanément. Ce qui donne plus de chance à la cohérence d’un projet.
Pourquoi n’est-ce pas évident ?
Parce que j’ai installé le compositeur un an sans promesse de résultat. Mais il faut prendre le temps, et le risque. La création c’est croire sans preuve.
Votre intuition vous porte vers des metteurs en scène qui occupent une place et ont étonné à un moment de leur parcours…
En général, je suis très sceptique sur la transposition. Reprendre un opéra, raconter une autre histoire. La proportion de réussite est faible, il faut un génie pour faire ça. En revanche je pense qu’on a besoin d’apporter une dimension contemporaine, psychanalytique, pour toucher un public d’aujourd’hui. Lui donner davantage de sensation, plutôt que la réécriture du propos et du sens. On peut respecter l’œuvre en lui donnant une dimension plus contemporaine.
Je me suis donc tourné vers des artistes comme Valérie Lesort et Christian Hecq pour Le Domino noir. Dans cette œuvre, il y a un univers visuel et un vrai travail d’acteur. Il y a de l’audace mais reste l’œuvre Le domino noir. Cette équipe, la plus soudée possible, a été créée en amont. Pour La Nonne Sanglante, un sujet gothique de Gounod, on a fait appel à David Bobée. Il est dans cet univers et peut créer un visuel fort dans le respect de l’œuvre. Cyril Teste va lui apporter une lecture tridimensionnelle à l’opéra Hamlet, dans une expression onirique, visuelle. Je lui ai proposé Hamlet au moment où il commençait à concevoir Festen.
L’idée de résistance est à l’origine même de l’Opéra Comique…
Oui, c’est un lieu de résistance, de tentative. Tout ne réussit pas mais c’est un endroit possible. Quand on propose à Pauline Bureau de refaire La Bohême, l’exigence de l’opéra est là mais dans un format qui nous permet de voyager, d’aller dans des territoires où il ne va pas : musiciens sur le plateau, chanteurs, chœur. Avec un modèle économique particulier, on a d’excellents chanteurs et musiciens, on ne lésine pas sur l’équipe artistique. On fait ce que faisait l’Opéra Comique en son temps : une nouvelle version très accessible en français. Pour Orphée et Eurydice, un registre plus classique, nous nous sommes demandé ce que pouvait apporter l’Opéra Comique, avec nos moyens. Tout repose sur l’apparition, la disparition. On a donc demandé à Aurélien Bory d’imaginer un système scénographique permettant de chanter l’opéra.
Qu’en est-il de la relève de la création à l’Opéra Comique ? Qu’est-ce qui ramène la jeune génération de musiciens vers l’institution ?
Déjà la diffusion de son répertoire. On a vu de plus en plus de maisons le programmer en France et l’Opéra Comique a imprimé sa marque. On ne travaille pas avec des plateaux internationaux de stars, on fait appel à des chanteurs français de grande qualité, des jeunes aussi. Donc l’apprentissage se passe beaucoup sur les planches, avec l’idée de la transmission. Avec Jérôme Deschamps, il y avait une académie à l’Opéra Comique, je l’ai transformée en troupe. L’esprit de troupe, au sens où on fidélise un certain nombre de chanteurs, en les sollicitant sur des petites formes, sur des concerts, des récitals. On les sollicite sur des œuvres, les plus jeunes seront doublures. On identifie une famille d’artistes, on la réunit. Les plus jeunes travaillent avec des chanteurs confirmés dont finalement s’installe un usage, une pratique, une transmission, qu’on ressent beaucoup. 94% de nos chanteurs sont francophones, 87% sont français. Tout simplement parce que 90% de notre répertoire est français. Nous avons un vrai potentiel de chanteurs. Ils voyagent d’ailleurs de plus en plus, même les plus jeunes. Julie Fuchs, Sabine Devieilhe, Jodie Devos, et bien d‘autres chanteurs se sont révélés sur les planches de l’Opéra Comique.
Vous avez également installé une maîtrise populaire ?
Oui, c’est une belle aventure sociale, qui a la double labellisation Égalité et Diversité. C’est le début. Quand Sarah Koné m’a parlé de son projet, j’ai trouvé ça formidable. C’est un projet éducatif et social, conjugué à une ambition artistique. C'est une classe à horaires aménagés musique, avec une méthode intuitive et une pédagogie très particulière. Elle essaime dans les quartiers, créant une vraie mixité sociale avec une maîtrise pluridisciplinaire. Et le fait qu’on veuille la faire jouer ici comme une production normale, qu’on intègre des enfants, rend saisissante l’ambition artistique, tout comme l’enjeu sociétal et pédagogique.
Précisément l’enjeu sociétal n’est-il pas une projection sincère des créateurs d’aujourd’hui ?
Il y a plusieurs raisons. Une raison économique, une raison de société, et une raison historique. Le mécénat, le financement, même le ministère de la Culture, le plan d’éducation d’action culturelle sont au cœur du projet artistique. C’est un enjeu culturel, politique, qui concerne tout le monde. Quand on est créateur ou producteur, on s’y intéresse aussi parce que nous sommes de plus en plus sensibles aux sujets de société. On prend conscience de notions qui nous échappaient un peu.
Il y a aussi une belle raison historique. Avec Monteverdi, l’opéra dit au roi "regardez, les planètes, les dieux, le cosmos". Sous Mozart, on dit "Majesté le monde n’est pas exactement celui que vous pensez". Avec Beethoven le monde est celui que je ressens, avec Wagner et Verdi, c’est celui que je ressens et j’en fais un hymne nationaliste. C’est l’éclatement au XXe siècle, il n’y a pas un opéra, il y a des opéras, des écritures. Il n’y a pas un monde, il y a des îlots, tout est éclaté. L’opéra du XXIe siècle est celui qui rassemble. Il est forcément social. La société pose ces questions aussi clairement, ainsi que celle du mécanisme d’accompagnement et de financement.
L’opéra ne s’est-il pas coupé de la société ?
Précisément. Nos considérations aujourd’hui sont : comment on le remet plus au cœur de la société. L’ouverture, l’accessibilité, la diversité, l’égalité, l’action culturelle, l’éducation sont devenues prioritaires.

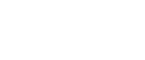 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
