Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Sauvage Sylvain Wavrant ?
« J’ai fait un rêve, que j’ai appelé La colline aux renards. J’étais en pyjama sur une colline verdoyante, de nuit, la lune, un arbre mort, et je passais pieds nus entre une quarantaine de renards, avec l’impression qu’ils pouvaient me dévorer. J’avais la sensation d’être confronté à une meute et de ne pas être l’espèce la plus évoluée face à de tels prédateurs. » L'artiste taxidermiste Sylvain Wavrant a voulu recréer ce rêve avec une vingtaine de renards naturalisés posés sur du gazon naturel, lui assis. Dans la salle d’exposition qui accueillait l'installation, le public était obligé de passer sur l’herbe et de traverser la meute, comme dans son rêve. " Des gens ont crié, d’autres étaient au bord des larmes. Le public ne savait pas si les renards étaient morts ou vivants, si l’installation traite de la vie ou de la mort. "
Pour Sylvain Wavrant, tout a commencé à Rennes. Alors qu’il préparait son master à l’école des Beaux-Arts, il a cherché une manière de se reconnecter au monde animal, celui de son enfance passée en Sologne et ses forêts giboyeuses. Sa rencontre avec le plasticien-taxidermiste Thierry Dupeux, qui y enseigne, fut déterminante. Ce tuteur de recherche lui a appris la technique de la taxidermie, et à récolter des animaux morts au bord des routes. Ses premières réalisations ont accompagné son mémoire intitulé Cabinet de l’homme et de l’animal, qui traverse l’histoire du rapport entre l’homme et l’animal, depuis les dieux égyptiens au fantastique, depuis les cabinets de curiosité aux museums, pour en faire un médium contemporain.
Son diplôme en poche, bien décidé à lancer une entreprise de créations animalières, il s’installe à Rouen, où il continue à créer des pièces. Sylvain organise une première vente dans son atelier show-room. C'est un succès. Il réalise ensuite quelques incursions dans le milieu du théâtre avec la création d’accessoires. Thomas Jolly lui confie la création des costumes d’Henry VI, adaptation acclamée en 2014 au Festival d'Avignon, et deux ans plus tard de Richard III. Avec cette collaboration, qui offre à ses créations une dimension médiatique de tout premier plan, il perçoit la dimension sculpturale du costume. Une prise de conscience qui le conduit vers une création plus manifeste. Mais là ne s'arrête pas sa soif de découverte. Il commence à réaliser des curiosités, des sculptures, des installations. « Je pense toujours à mes parents. Je viens de la campagne, je veux qu’ils puissent comprendre mes pièces sans avoir besoin d’absorber l’histoire de l’art et le monde contemporain. »
Le regard porté sur l'œuvre. Son public va de l’écolier au chasseur du coin ou à la bourgeoise en manteau de fourrure que la vue d’un animal mort offusque. Avec ses allures d'éternel enfant, Sylvain Wavrant a affuté ses arguments. Ceux de l’artiste. Imparables. Et guidés par la beauté. Quand il pare la tête d’un oiseau de perles de cristal, il attire le regard sur une splendeur qui mêle astucieusement les artifices les plus flatteurs à une nature où, il y a peu, habitait la vie. Quand il assemble les plumes d’un faisan ou ceux d’une ménage pour composer un bustier, il pare l’homme d’attributs où la vie est définitivement enfermée par la magie de la taxidermie. Quand le regard est pris au piège de la beauté, il est moins facile de le détourner, mais Sylvain sait que bientôt la répulsion va survenir. Il la devance alors en répondant aux questionnements qui ne manquent jamais de surgir. Dans ses expositions, il est souvent présent, il y a des médiateurs ou encore des livrets de médiation pour parler de ces sujets. « Généralement j’arrive à convaincre en quelques minutes. Je ne tue pas les animaux, je suis végétarien. Je suis là pour mettre un projecteur sur des sujets qu’on veut oublier : les accidents de la route (première cause de la mortalité de la faune sauvage) et la vente de la fourrure (qui représente 60 millions d’animaux tués chaque année). C’est un art militant mais je ne veux pas d’un art conceptuel ni illustratif. Je suis dans l’entre deux. J’aime qu’on puisse y avoir accès esthétiquement, symboliquement.»
En parallèle à sa pratique artistique, il organise des actions culturelles avec le jeune public en milieu scolaire. Et enrichit ainsi son talent de pédagogue pour expliquer l’animal, la nature, et l’urgence dans laquelle le monde se trouve.
Nos années sauvages, la meute. « C’est un vrai enjeu, un enjeu que nous défendons aussi avec Nos années sauvages ». C’est le nom que lui et Thomas Cartron ont donné à un collectif, alors que les deux amis étaient étudiants aux Beaux-Arts de Rennes. Le premier projet Nos années sauvages fut un cycle autour de l’animalité et de l’environnement : Naissance, vie, mort. Une trilogie à laquelle est venu s’ajouter Résurrection. À Rouen, où Thomas Cartron vit aussi, ils ont ouvert le collectif à d’autres arts : aujourd’hui la meute compte une vingtaine d’artistes, émergents ou confirmés, de tous horizons. De ce qu’ils considèrent leur laboratoire, ont émergé des petites formes qu’ils ont produites dans des bars, et dans des lieux alternatifs. En novembre prochain, la meute investira la majestueuse église abbatiale Saint-Ouen. En vue de l'exposition, Sylvain s'exerce à mettre au point une série composée de « manteau de fourrure sous grillage, avec le logo des grandes marques de haute couture qui les ont commercialisées ». Avec l'idée de « montrer que c’est un animal et pas juste de la matière ». Les projets fusent dans son esprit, comme celui de travailler sur l’olfactif du cadavre, de la dépouille… À suivre.

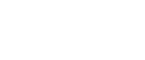 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e






