Vous n'avez pas de compte ? Enregistrez-vous
Mot de passe oublié ?Sultan Ulutas : « J’ai trouvé une sorte de liberté dans cette langue »
Comment est né le texte La langue de mon père ?
J’ai commencé à l’écrire au moment où j’attendais mes papiers pour rester en France. J’ai grandi dans la région de Thrace et à Istanbul, puis je suis venue en France, à Lyon, il y a six ans pour poursuivre mes études de théâtre. Une fois terminées, je n’avais plus le droit de rester en France. J’ai fait la demande d’une carte de séjour, la procédure a pris du temps. C’est à ce moment que j’ai décidé d’apprendre la langue maternelle de mon père, le kurde. En apprenant cette langue, beaucoup de questions se sont imposées à moi, auxquelles je voulais trouver des réponses. J’ai alors commencé à écrire, le texte est né de cette expérience et des souvenirs de mon enfance. Je l’ai écrit en français pour tenter de comprendre.
Comment es-tu passée de ton expérience personnelle à la scène théâtrale ?
Au début je ne savais pas que ça deviendrait une pièce. Je suis comédienne depuis maintenant treize ans et je devais passer par une forme théâtrale même si j’écrivais pour moi-même. C’était une forme de lettre adressée à mon père, qui a quitté notre foyer quand j'étais petite, mais pas seulement. J’écrivais en français, une langue que ma famille ne comprend pas, et en même temps je racontais une histoire aux gens autour de moi. À l’époque, fin 2019, je ne maîtrisais pas bien le français mais j’avais trouvé une sorte de liberté dans cette langue pour pouvoir parler de ce sujet, l’identité et la relation père fille.
Au fur et à mesure de mon écriture, j’ai interrogé le choix d’écrire en français. Ce sujet était un peu tabou, difficile à dire et même à penser dans ma langue maternelle.
Il y a trois langues dans ce texte : le turc ma langue maternelle, le kurde que je commençais à apprendre, et le français pour lequel j’étais en apprentissage. Il est donc écrit dans mon français de l'époque, avec les fautes que je faisais.
Pourquoi apprendre le français ?
Je suis née à Istanbul, mais ma mère est turque et mon père est kurde. Pendant mon enfance, je vivais toujours cet entre-deux. Comme si je devais choisir un camp. Il y avait une confusion sur mon identité, en moi et dans la société. J’ai commencé à apprendre le français à 27 ans, à l’Institut français d’Istanbul, et, un an après, j’étais en France pour faire un master.
En quoi la langue est-elle constitutive d’une identité ?
C’est très complexe. D’abord il y a des pays qui choisissent une langue nationale. En Turquie la langue officielle c’est le turc, en France c’est le français. Le kurde est une langue qui a été longtemps interdite par la loi en Turquie. En France j’ai appris que le breton avait aussi été interdit. Il y a des enjeux politiques par rapport à ça, du coup ça te définit en tant que personne même si tu n’es pas au courant de tout ça. Mis à part cela, mon rapport à la langue est intime. Je m’interrogeais au niveau des sons, je me demandais quelles chansons mon père entendait quand il était enfant, comment il parlait cette langue. Dans chaque langue il y a un imaginaire, une manière différente de penser, je trouve ça très intéressant. Une langue qu’on ne parle plus, alors que nos ancêtres ont communiqué dans cette langue, il y a une richesse perdue par rapport à ça.
Tu as voulu apprendre le kurde, une langue qui a été longtemps interdite et qui ne t’a pas été transmise…
Je ne l’ai pas apprise, c’était le choix de mon père, son rapport familial. Lui a fait le choix de ne pas parler en kurde parce qu’on ne parle pas le kurde à Istanbul. Pour moi, apprendre cette langue c’était aussi une manière de me connecter à mon père, à tout ce que je ressentais par rapport à mon identité, d’interroger aussi la honte que j’avais eue vis-à-vis de mon identité depuis mon enfance.
Cette identité kurde, dont tu parles dans ta pièce, engendre des brimades de la part d’élèves, n’est pas bien perçue par la société stambouliote…
À l’époque, j’ai été témoin du racisme quotidien. Je ne peux pas dire que j’ai défendu cette identité dans mon enfance puisque je ne connaissais pas la culture kurde. Mon père vient de l’Est de la Turquie et j’ai appris, je ne sais ni à quel moment ni comment, qu’il ne fallait trop le dire pour ne pas être exclu. Ce n’était pas interdit, mais je sentais que pour ne pas être exclu il valait mieux ne pas en parler.
Tu as débuté tes études en Turquie…
Après des études en ingénierie électronique et de communication, j’ai fait une école de théâtre à Istanbul pendant quatre ans pour devenir comédienne et où j’avais des cours d’écriture. En Turquie, nous avons des cours de pratique du jeu mais aussi théoriques, en écriture, en mise en scène, en histoire du théâtre. J’ai commencé à travailler en tant que comédienne pendant mes études et, une fois diplômée, j’ai continué à jouer, au théâtre et dans des séries télévisées. Mais quelque chose me manquait. Je gagnais bien ma vie mais ce n’était pas ça dont je rêvais. Il n’y avait pas assez de création. J’ai alors fait un master en film et art dramatique dans la même école, et j’ai repris des cours d’écriture. J’ai voulu écrire mon mémoire sur : jouer dans une langue étrangère et le sentiment d’étrangéité. Je n’étais pas étrangère dans mon pays mais c’est un sentiment que j’avais porté longtemps et qui m’intéressait toujours. D’autre part, dans la pratique de comédienne, sur scène il y a toujours ce sentiment d’étrangéité, d’aliénation. Ça m’intéressait beaucoup. J’avais entendu parler d’une professeure à l’ENS de Lyon qui travaillait avec des élèves étrangères sur le théâtre. Je lui ai écrit pour lui demander de diriger mon mémoire, elle a accepté. Il y a eu un accord entre les deux universités et j’ai pu arriver en France. J’ai étudié sous la direction d’Olivier Neveux, en même temps je rédigeai mon mémoire. Une fois que j’ai eu mon master, j’ai voulu continuer à pratiquer en français. J’ai candidaté et été acceptée au Conservatoire national d’Art dramatique en tant qu’élève étrangère. J’ai intégré la deuxième année.
Le sentiment d’étrangéité t’a poursuivie, t’a conduit en France, tu as obtenu ta carte de séjour. Le sentiment d’être étrangère t’habite et te porte toujours ou est-ce une page tournée ?
Ce sentiment s’est transformé. Je me suis toujours sentie étrangère, et je me demandais comment j’allais me sentir étrangère dans un autre pays. Au tout début je ne me voyais pas comme une étrangère en France, je ne me sentais pas comme venant d’ailleurs. Je ne veux pas dire que j’ai vécu du racisme en France, c’était plus les regards des autres qui m’ont renvoyé mon étrangéité à moi-même. À partir de ce moment, je me suis rendu compte que j’étais étrangère. J’ai grandi à Istanbul, j’ai beaucoup voyagé à l’étranger, je ne me suis pas enfuie de mon pays, je suis venue faire mes études, mais le regard des autres me renvoyait toujours au sentiment de « tu n’es pas d’ici ». Même bienveillant, bien intentionné, je ne l’ai pas très bien vécu, je ne comprenais pas.
Quand les gens me regardent c’est comme si je venais avec un bagage de l’histoire de mon pays, de sa politique, comme si je le représentais. Je devais tout savoir. C’était comme si j’avais un bagage de tout ce qu’on montrait à la télévision française sur la Turquie. Alors que je ne suis pas au courant de tout et qu’on ne vit pas toujours la même chose que ce qu’on montre à la télévision française. C’était très réducteur et ça m’a permis de voir qu’il n’y a pas de place à trouver dans ce pays, il faut que je crée ma place. Si je veux vivre ici il faut que je montre mon travail.
Et ton premier travail c’est La langue de mon père, un seul en scène que tu as joué à La Manufacture dans le OFF d’Avignon…
Au départ je voulais juste faire une lecture à Lyon, où j’avais fait mes études, où j’avais des amis, pour avoir des retours. Patrick Penot, le directeur du festival Sens Interdits, est venu m’écouter. J’avais connu ce festival pendant mes études et ça avait été une révolution de voir qu’il est possible de faire du théâtre sur ces sujets. Après la lecture, Patrick Penot m’a invitée à Contre Sens, un festival créé à la suite de l’invasion russe en Ukraine. La directrice de théâtre où je faisais la lecture m’a proposé de me programmer la saison suivante. D’un coup je me suis dit : ok maintenant il faut que je fasse un spectacle de théâtre. Aujourd’hui le texte est édité grâce à Patrick Penot. Le bureau des filles, le bureau des paroles m’accompagnent. Le spectacle est labellisé Sens Interdits et il est programmé la saison prochaine, en septembre au festival Les accueillantes en Isère, du 23 janvier 2024 au 2 février au TNS à Strasbourg, et du 12 au 14 mars à la Croix Rousse à Lyon.
Quels sont tes projets ?
J’en ai plusieurs. Maintenant que des gens m’accompagnent et que mon seul en scène est lancé, j’ai plus de place pour des projets d’écriture. J’ai commencé à travailler sur un spectacle sur les supermarchés de la grande distribution en France.

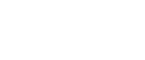 le journal des créations du 21e
le journal des créations du 21e
